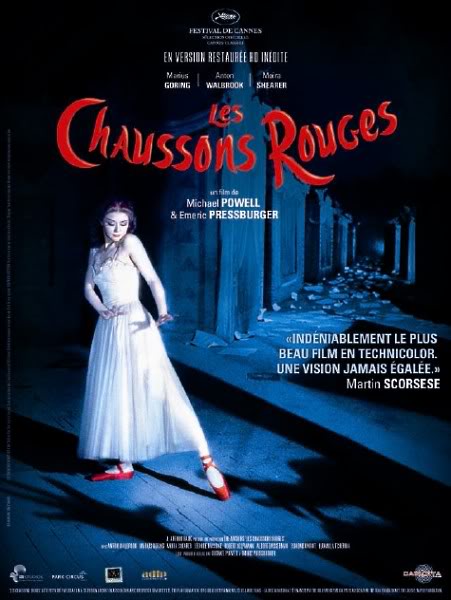Vendredi 23 avril, dimanche 2 mai et jeudi 6 : trois représentations de l’hommage à Jérôme Robbins, soirée ainsi intitulée de manière à pouvoir y glisser un intrus -néanmoins très désirable-, une chorégraphie de Benjamin Millepied. La première fois, Palpatine, Amélie (blogueuse rencontrée fortuitement sur les banquettes rouges des pass jeunes) et moi obtenons des places de dernière minute au centre du premier rang du premier balcon, la perfection absolue. Les deux fois suivantes étaient en revanche prévues, si bien que ce n’est pas nous qui dérobons les places de quelques riches invités dédaigneux, mais la scène qui se dérobe en partie à notre regard (à Amélie a succédé une demoiselle que j’appellerai pour le moment Esméralda – quoique, j’hésite avec Shérérazade- puis B#4). La loge impératrice accepte à la rigueur le sceptre mais non pas les cannes ; passé le premier rang, il faut être debout pour voir au mois les deux tiers de la scène, ce qui est un peu frustrant en temps normal, mais une parfaite solution pour voir plusieurs distributions sans se ruiner (surtout quand, mine de rien, on se fait inviter – ou alors j’ai une dette inconnue ?- ouais, c’est commode, les blogs, pour s’envoyer des billets doux).
En sol e(s)t sur la mer, les danseuses sont vêtues de tuniques qui rappellent leur parenté avec le maillot, ornées de vaguelettes de couleurs et de jupettes assorties, de même que les danseurs (assortis, pas en maillot, voyons – à moins de penser au maillot des cyclistes, mais les académiques sont autrement plus seyants). Battements, sixièmes et déhanchés : la chorégraphie serait jazzy si la séduction n’avait pas été remplacée par l’entrain. Les groupes se scindent pour mieux se faire écho, trois se donnent la main de sorte que l’arabesque du premier se répercutent sur les suivants, trois autres se lancent dans un concours de chats six jusqu’à couler s’écrouler, ça déboule en lignes et repart en file serpentant comme la traîne d’un cerf-volant. La composition des ensembles est d’une inventivité débordante chez Robbins ; lorsque j’ai découvert son style, à la venue du NYCB l’année dernière, ma première impression a été celle d’une fluidité insaisissable, tant les figures des ensembles vous filent entre les mains avant que vous ayez eu le temps de les constituer en formes géométrique stables et identifiables. Il faut suivre l’exemple des danseurs, sauter depuis un grand plié secondes sur le côté, un bras de crawl, et plonger dans la danse.
La danse facétieuse et énergique des ensembles encadre un pas de deux qui tient plus du calme du large de la Méditerranée lorsqu’elle est d’huile que du joyeux bazar de ses plages. Les costumes (de bain) du corps de ballet sont épurés, et le couple central se détache en blanc sur l’azur uniformément bleu du cyclo (à l’exception de trois vaguelettes et quatre rayons stylisés). Le pas de deux est éblouissant : rien que des lignes pures, rien de spectaculaire, tout disparaît comme dans l’éclat d’une lumière trop vive. Cela passe et s’oublie comme un éblouissement. L’espèce de tranquille sérénité qui s’en dégage module la tonalité de la pièce entière et empêche la joie des danseurs-nageurs de n’être que ludique, innocente, et enfantine. C’est un peu plus profond, mais comme l’eau est un peu trouble, difficile de voir exactement en quoi.
Distributions :
Karl Paquette est délicieux, comme toujours ; Marie-Agnès Gillot, puissante, comme à son habitude, mais leur pas de pas paraît fade au regard de ce que l’on aurait pu attendre. Bien que leurs physiques s’harmonisent plutôt bien (ce qui n’est pas évident avec la stature de Gillot), ils manquent de complicité pour former un couple. Dans cette juxtaposition, Karl Paquette paraît même avoir du mal à manier la grande perche qui lui a été assignée.
Aurélie Dupont et Nicolas Leriche sont en revanche tout à fait incapables de décevoir. Le pas de deux prend tout son sens dans l’écrin du ballet qui ne semble plus un simple prétexte à son insertion. Après Gillot, Dupont me rappelle leur cohabitation explosive dans les Rubis de Joyaux. Elle a toujours le geste juste (et) intense. Leriche a déjà tout compris en trois attitudes glissées dans le sol, les bras qui avancent au ralenti comme si les mains flex éprouvaient la densité de l’air. Et il s’amuse, avec ça. Pas comme un jeune chiot fougueux sur la plage. En tant qu’artiste qui prend un immense et très simple plaisir à être sur scène, qui se joue des difficulté, joue avec sa partenaire, le corps de ballet et les accents de la musique de Ravel – on jubile avec lui. Heureux sans être insouciant : son sourire qui fond en bouche.
Josua Hoffalt s’amuse aussi, mais de façon plus malicieuse. Charmeur, aussi. Ce qui n’est pas pour le desservir ni pour me déplaire. Il n’en fait pas trop de ce côté, mais semblerait se reposer là-dessus pour compenser un manque d’énergie – ou de dynamique, je ne sais pas trop. Mais l’intelligence de ses mouvements tout de retenue promet (il adopte un peu la gestuelle de Leriche dans sa traversée en attitudes, sauf sa main, plus ronde, dont on se demande si elle ne manquerait pas de fermeté), et il faut ajouter à sa décharge qu’Emilie Cozette n’invite pas à l’allégresse. Bien que je ne m’attendais pas à ce relatif aplomb technique (encore qu’elle peinait visiblement dans la diagonale de coupés-jetés en tournant), elle ne me fait toujours pas plus d’effet qu’une belle algue (j’en connais un qui serait ravi de s’en faire un makisushi).
Triade, cheval de Troie de la soirée, est une pièce de Benjamin Millepied, celui-là même qui a chorégraphié Amoveo et qui mérite donc doublement que je lui déclare mon amour. C’est juste… rhaaaa. Mais encore me direz-vous ? C’est que je ne sais pas trop par où commencer. Même le titre ne se laisse pas facilement décortiquer (le programme, que j’ai feuilleté à la boutique de l’opéra, n’en dit rien – belles photos mais seulement des bios, je l’ai reposé bien sagement sur la pile) : trois notes, trois éléments qui font réagir curieusement l’alchimie du couple, trois combinaisons possibles de rencontre… ? C’est qu’ils sont quatre en scène, deux hommes et deux femmes : autant trois est le chiffre des emmerdes (il y en a toujours un qui tient la chandelle), autant l’ajout d’un quatrième donne aux embrouilles le beau nom de complexité. Dynamique assurée. Les duos unisexes ont tôt fait de se recomposer en couple qui eux-mêmes s’échangent. Mais quand un troisième vient à passer (voire à narguer), il y en a toujours un pour se souvenir du couple précédant et hésiter sur son partenaire. Pas de jalousie, plutôt l’indécision d’une infinie curiosité – suspendue par une échappée finale ; pas de plan à trois, une complicité à quatre.
Dans les va-et-vient de ce petit groupe, on se repère aux couleurs, trois, histoire de jouer une fois encore sur un
équilibre qui ne peut aboutir à une parfaite symétrie et se cherche donc sans jamais se stabiliser : un couple bleu, une femme rouge, un homme vert. Le mini-short et le top style nuisette ne sont pas des plus adaptés à la morphologie de Marie-Agnès Gillot dont Shérérazade souligne qu’elle aurait pu faire une carrière de camionneur. Ce n’est pas faux ; il n’empêche, elle est belle. Ses épaules massives, justement, la situent au-delà de la séduction et ses rapports avec ses partenaires en sont d’autant plus intenses.
J’adore le moment où de profil au public et face à Vincent Chaillet (T-shirt vert), elle avance, tourne et recule la tête au rythme où celle de son partenaire recule, tourne et avance. L’amorce d’un baiser prend d’étranges allures de crainte (oiseau apeuré) et curiosité animales (bêtes qui se sentent – la focalisation passe des lèvres au nez sans que l’intervalle entre les visages ait été modifié). Un bras qui sabre l’air au-dessus du torse vert qui s’est reculé et c’est une masse bleue qui tombe en arrière inerte au bras de l’homme. Jambes pliés, genoux vers le public – abandon. Et puis aussi son arabesque plongée, qui me renvoie dans un flash à Genus (décidément, cette soirée est indépassable).

Et la main de son partenaire qui la retient à l’horizontale par la cuisse, l’autre jambe frôlant le sol, également pliée. Et la façon dont elle fixe quelque chose hors-scène, l’intuition de la présence de quelqu’un, le regard fixement dirigé vers la coulisse à laquelle Vincent Chaillet tourne le dos ; et alors, la façon dont elle se jette dans ses bras pour tout à la fois ne pas voir (buste protecteur où elle trouve refuge) et voir (sous son bras à lui – si c’était par-dessus, la polysémie d’übersehen conviendrait parfaitement), la jambe calée par le pied résolument en dedans.
Distributions :
Je vais essayer de résister à la tentation de décrire pas à pas le rôle de Gillot et dire deux mots (enfin deux paragraphes, vous me connaissez) du trio restant. Surtout que mon enthousiasme masquerait presque le fait que la distribution ne colle pas : Gillot et Gibert sont toutes deux formidable, mais leur similitude et compatibilité s’arrête à la deuxième lettre de leur nom. La force sculpturale de celle-là et la désinvolture coquette de celle-ci sont constamment en porte-à-faux l’une par rapport à l’autre. Les moments que j’ai évoqué juste avant sont en réalité issus d’un pas de deux où le couple est un long moment seul en scène, et qu’on peut alors oublier un instant que les deux étoiles n’appartiennent pas à la même constellation. Les garçons sont plus homogènes : Vincent Chaillet en T-shirt vert et Nicolas Paul en marcel bleu ondulent, tournent et ploient plus harmonieusement, encore que la chorégraphie les fasse rarement danser à l’unisson. En effet, comme ils ne cessent de se recomposer, les couples dansent rarement ensemble, même lorsque les quatre danseurs sont rassemblés sur le plateau. La cohésion de leur danse est d’autant plus importante que la juxtaposition des couples a vite fait de devenir un collage arbitraire.
La première distribution que j’ai vue était bien plus cohérente (ce n’est pas une question de taille, la disproportion qui était entre les filles se retrouve chez les garçons), et même sans étoile de recommandation, je l’ai largement préférée à la suivante. Stéphanie Romberg (en bleu, comme Gillot, dont elle pourrait rejoindre un jour la constellation) affirme toujours une belle présence, alliée à une technique plus assurée, tandis que Muriel Zusperreguy me donne encore un peu plus envie de retenir l’orthographe de son nom. Quant aux garçons, c’est l’extase : une fois dépassé le fait que je ferais bien mon quatre heure d’Audric Bezard (T-shirt bleu), difficile de dire qui, de lui ou de Marc Moreau (marcel vert – z’avez remarqué, ils ont inversé le rapport forme-couleur ; ça m’a perturbée pendant toute la deuxième représentation au point que je suis allée vérifier dans les photos du programme) est le mieux. Marc Moreau est plus souple des épaules, les ondulations sont plus coulées , tandis que l’ampleur des mouvements d’Audric Bezard tient davantage à la puissance de ses immenses jambes et à la tenue de son dos (oui, bon, d’accord, de son torse, mais c’est la même réalité vue de face et de dos). Ils sont également formidables et tous me font trépigner ne serait-ce que par une course qui s’achève en coulisse ou en dérapage contrôlé. Une pièce sous tension hautement enthousiasmante.

Myriade d’étoiles In the Night : pas moins de cinq titrés pour trois couples, et un fond de scène parsemé de points lumineux. Le public ne pousse pas un oooh de ravissement comme devant la guirlande métallique des Diamants – les Joyaux, encore- mais je n’aurais pas été en reste. Ce fragment de voie lactée est très discret (cela me rappelle la lumière du soleil qui filtrait le matin à travers mon vieux store occultant piqueté de petits trous), mais il suffit à perdre le spectateur dans l’espace, que dis-je, le cosmos de la scène. Les pas de deux qui se déroulent dans cette obscurité liquide semblent présenter l’origine de tout couple, qui existe par conséquent de toute éternité. Ainsi soustraits au temps dans une parenthèse hors du monde, j’ai du mal à y voir trois âges d’une relation amoureuse. Trois états me semblent bien plus convenir à ces couples au-delà d’une triviale phase de séduction (critique bien lourdingue de Télérama, à ce propos). De la tendresse respectueuse à la passion épanouie en passant par la majesté des sentiments, ces couples dans la maturité de leur relation dégagent une sensation de plénitude incroyable, même lorsque la femme se retrouve emportée la tête en bas. S’ils se succèdaient vraiment, les trois états ne se retrouveraient pas après leur mouvement respectif pour finir sous le même ciel.
Distributions :
Benjamin Pech aurait un peu l’aspect princier de la Bête face à une belle Clairemarie Osta en robe violette, à qui convient décidément les rôles qui requièrent encore davantage de finesse et de délicatesse que de nuance (la, ce serait plutôt Aurélie Dupont). Comme dans Émeraudes (ça y est, j’ai cité les trois tableaux des Joyaux, ce devrait être bon), elle cisèle ses mouvements, les détache en suivant les pointillés de son intention. Je suis chaque fois suprise favorablement, oubliant chaque fois sa personnalit
é si peu imposante – ce n’est pas qu’elle s’efface, non, elle se propose. On la qualifiait dans je ne sais plus quel commentaire de « femme qui danse ». J’avais trouvé cela stupide sur le coup, et je commence seulement à entrevoir ce qu’on voulait sûrement dire par là. Toutes les étoiles dignes de ce nom sont des artistes, c’est-à-dire autre chose que des danseuses : Aurélie Dupont est une comédienne qui danse, Marie-Agnès Gillot, une athlète qui danse… Clairemarie Osta est une femme qui danse. Bien qu’elle ne figure pas à ma connaissance dans ses fantasmes, elle possède la patine dont parle Palpatine et qui en fait une belle femme tandis que Muriel Zusperreguy dans ce même rôle ne peut être encore qu’une jolie fille, même très jolie.
Et il va sans dire que Jérémie Bélingard qui ne me fait pas plus d’effet que Stéphane Bullion (qui lui-même ne m’en fait pas plus que Cozette – vous commencez à voir le problème) ne peut pas rivaliser avec Benjamin Pech, même dans le rôle de porteur – puisqu’il faut bien reconnaître que le rôle des hommes est assez limité dans cette pièce. La dernière distribution aura au moins eu le mérite de m’apprendre à distinguer Bélingard et Bullion. Je garderai pour moi les noms d’animaux qui me servent de moyen mnémotechniques, ne trouvant pas comme Amélie que Jérémie est le beau gosse des deux frisés.
Le deuxième couple doit sa majesté à Agnès Letestu, absolument parfaite dans les rôles classiques où il n’y a pas besoin de sourire ou de minauder. De son port de tête, et de la pose souveraine marquée d’un côté puis de l’autre par sa pointe en quatrième derrière, elle assoie son autorité sans entamer sa délicatesse. De Robbins, je pourrais retenir la beauté d’une simple marche, la scansion de celle-ci ou les menés de En sol qui rapprochent progressivement le couple après quelques avancées et reculs en diagonale. Enfin, Agnès Letestu est un diamant brut, tranchant mais pur. La robe mordorée est également sublime et achève d’éclipser Bullion. Karl Paquette aurait pu être royal, mais on ne lui veut décidément pas du bien dans l’attribution de ses partenaires : Emilie Cozette tient son rôle mais pas son rang, elle s’en sort grâce à sa beauté. Les étoiles blondes auraient pu former un couple solaire, en pleine nuit, c’est malheureusement mal venu. La dernière distribution rassemblait Christophe Duquenne et Eve Grinsztajn dont il faut absolument que j’apprenne à prononcer le nom. Sans avoir bien sûr la maturité de ses aînées, elle est superbe, une gorge (pas le cou ni la poitrine, la gorge au sens ancien du mot, comme le poitrail d’un animal) bombée plutôt que concave, qui semble donner le ton pour tous ses mouvements enrobés (la façon dont elle semble prendre appui sur l’air pour y mieux flotter, rho). Avec la couleur de la robe, elle suscite en moi une nouvelle réminiscence de la Belle et la Bête (Disney power).
Last but not least : Delphine Moussin, juste sublime, à plus forte raison lorsqu’elle est accompagnée de Nicolas Leriche. Sa robe, déjà, est une pure merveille : le tissu sombre s’ouvre sur des voiles orangés qui rendent des portés a priori acrobatiques, flamboyant. La flamme de la passion n’a plus rien d’une métaphore éculée et d’ailleurs les emportements du couple ne sont plus ceux d’adolescents amoureux, mais déjà, à présent, ceux d’amants qui s’abandonnent l’un à l’autre, sortent d’eux-même et du nacissisme amoureux pour redonner à la passion son sens passif de ce qui est subi – mais il faut voir avec quel désir, aussi. Delphine Moussin est juste sublime, et n’a pas l’air inspiré que peut prendre Emilie Cozette : elle, est inspirée et surtout inspire, expire, respire, sa poitrine se soulève, elle vit devant nous, sur scène, oublieuse de nous, s’abandonne.
Vous avez vraiment besoin d’une conclusion pour cette pièce ou je dois ajouter que c’est le ballet pour lequel le jeu des chaises musicales dans la loge aurait pu devenir moins ludique?

The Concert terminait le programme parce qu’il est bien connu que la plus perdue des journées est celle où l’on ne rit pas (pas de souci de ce côté, je me suis payé un bon fou rire ce matin). La mise en abyme est annoncée par un second rideau où se trouve dessinée la salle. Côté jardin, un piano à queue, bientôt rejoint après une descente triomphale par sa musicienne. En bons spectateurs, on applaudit ; c’est comme ça, on applaudit les musiciens avant et les danseurs après. Ce n’est qu’après avoir bidouillé son tabouret pendant une éternité, dans le silence, et épousseté le clavier d’une décennie de poussière accumulée que la pianiste accède au rang de personnage comique.
La pièce commence vraiment ; ses rouages vont s’enrayer de façon de plus en plus improbables. Jeu des chaises musicales de spectateurs insupportables, affres du corps de ballet, petits désaccords entre mar(r)i et épouse, le délire devient complètement loufoque et s’achève par une gigantesque chasse aux papillons. La satire est cruellement drôle, et c’est bien la seule fois que vous aimez chrétiennement vos prochains dans une salle de théâtre ; quand bien même vous auriez ce soir-là un spécimen d’emmerdeur pour voisin (tuberculeux, pipelette, bruyant…), aucune importance, vous rirez plus fort que lui.

Il faut surtout mentionner Dorothée Gilbert, vraiment impayable dans le rôle de la ballerine : le rire prend rien qu’à voir la façon dont elle reste accrochée au piano après qu’on lui ait ôté sa chaise de dessous les fesses, sa gêne lorsqu’après une poignée de main celle de son interlocuteur reste dans la sienne et qu’elle dissimule l’objet compromettant dans le piano, son émerveillement face à un chapeau défiant toutes les moumoutes à fanfreluches que vous puissiez imaginer, la tronche qu’elle tire lorsqu’elle se prend un coup de gourdin sur la tête (oui, oui, c’est très animé).

A la satire courante s’ajoutent les références parodiques au ballet, d’abord entendu de façon générique puis sous forme de clins d’œil aux ballets blancs. Il y en a toujours une pour se planter de place ou de mouvement dans le corps de ballet. Leur pose « finale » est un sommet : après moult déséquilibres et hésitations quant à la position à prendre, les danseuses se figent avant de remarquer que l’une a le mauvais bras, ce qui entraîne illico presto la rectification de toute la ligne… enfin presque, puisqu’il y en a encore u
ne qui est à la masse et qui au lieu d’assumer son erreur, essaye de feinter en revenant trèèèèèès lentement dans le bon port de bras. Jubilatoire. Je suis morte de rire, aussi, lorsque des sylphides dégénérées en papillons débarquent aux quatre coins de la scène, reconnaissant les entrées des Willis. La formidable Myrtha qu’ils trouvent en la figure de l’épouse est malheureusement piétinée par ses compatriotes lors qu’une mauvaise synchronisation des traversées. Scrabouillée, la bestiole. Et de battre des mains comme une otarie après cette parodie tordante. Concert d’applaudissements.