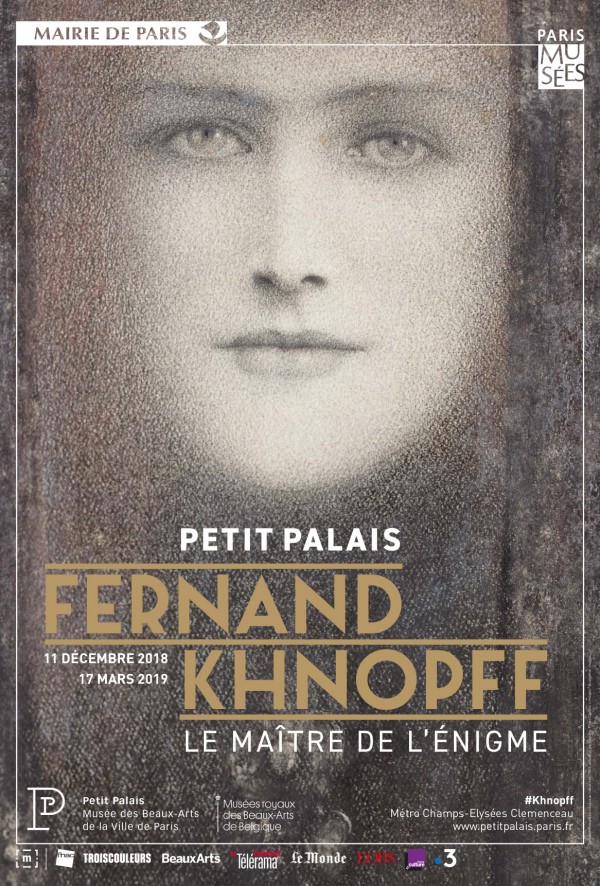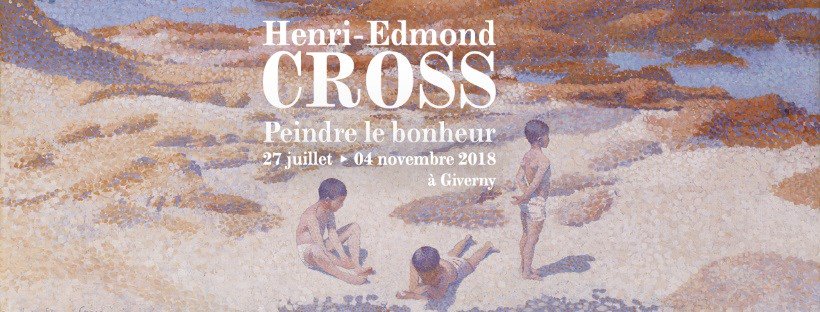L’exposition Toutânkhamon installée à la Villette s’articule autour de deux pôles d’identification : vous pouvez au choix vous imaginer pharaon ou égyptologue. La première partie de l’exposition est consacrée à la mythologie, chaque objet étant l’occasion de détailler le parcours du pharaon dans l’au-delà – un parcours assez confus, qui tantôt paraît ne devoir avoir lieu qu’une seule fois (avec des monstres à occire sur le chemin), tantôt s’inscrit dans la récurrence des jours et des nuits (l’esprit du pharaon quitterait la tombe chaque nuit sous la forme d’un oiseau). La seconde partie retrace rapidement les découvertes d’Howard Carter : les cadastres rayés au fur et à mesure des fouilles ; la photo du gamin chargé du ravitaillement, qui a buté sur la première marche menant au tombeau ; l’ellipse temporelle de dix ans, pour sortir et répertorier plus de 5000 objets – avec une guerre au milieu… Une dernière salle explique les découvertes plus récentes, grâce à des analyses ADN notamment : le pharaon n’est pas mort d’un coup à la tête, comme on l’a longtemps soupçonné, mais d’une piqûre de moustique – paludisme ou malaria selon les panneaux (j’ignorais qu’il s’agissait d’une seule et même maladie). (Je me demande à présent si un semblable laxisme dans la synonymie n’expliquerait pas la similarité entre le calcite et l’albâtre…)

L’histoire est le parent pauvre de l’exposition : il faut attendre d’avoir parcouru les trois quarts des salles pour voir un arbre généalogique – ce qui n’est pas du luxe sachant que Toutânkhamon a épousé sa demi-sœur… qui devait avoir accès au trône et pour qui pas mal d’objets avaient été préparés. De cela, les cartels ne pipent mot : il fallait avoir sous la main sa Mum pour vous l’expliquer, d’après un reportage visionné sur Arte. Quand elle me raconte cela près d’une statuette dorée censée représenter le pharaon, tout le monde autour de nous tend l’oreille et remarque subitement que le pharaon a des hanches et, oh ! des seins ! Piquer les objets des pharaons précédents, réels ou pressentis, était apparemment une pratique courante ; on grattait le cartouche du précédent pour y faire inscrire le sien et ni vu ni connu je t’embrouille. Cela fait sens quand on voit la richesse des objets, le travail titanesque que cela représente, et le laps de temps relativement court pour les créer : monté sur le trône à neuf ans, Toutânkhamon meurt dix ans plus tard… Paye ta légende.

Sinon, j’adore la couronne qui semble une parfaite courbe de Béziers… et, plus largement, la coexistence de deux pôles graphiques qui m’ont toujours semblé opposés : la pureté des lignes et la complexité de l’ornementation.
La carence historiographique s’explique probablement par ce qu’elle fait apparaître en creux : le pharaon le plus connu du grand public s’est moins illustré par son règne que par les richesses avec lesquelles il a été enfoui. Quelles richesses ! J’ai accompagné Mum voir l’exposition parce qu’elle trépignait de revoir les objets découverts enfant ; j’étais plus curieuse de voir son enthousiasme à elle que les objets qui le suscitaient. Je ne sais pas pourquoi, je m’attendais à pléthores de vases et poteries mi-cassés mi-dorés, de statues en terre cuite et de bijoux sans fantaisie… rien de tout cela. Je ne sais pas si les objets ont ou non été restaurés, mais cela brille de partout et l’on cède rapidement à l’émerveillement, mettant de côté toute réticence au bling-bling : ce sont des statuettes en bois recouvertes de feuilles d’or (des statuettes en bois de trois mille ans, en bois !) ; des bustes en calcite, vibrant de lumière (bref réveil de la très éphémère passion pour la géologie de mon enfance) ; des bijoux, des armes ciselés, d’une grande complexité ornementale… partout ou presque un travail de sculpture, d’orfèvrerie et d’ébénisterie incroyable. Contrairement à ce que j’aurais imaginé, les objets exposés s’apprécient en eux-même, indépendamment presque de tout contexte : ce ne sont finalement pas tant des explications historiques que je désirerais trouver dans les cartels, que des informations concernant les matériaux (certes énumérés) et leur travail.

Alors, aller voir l’exposition ou non ? Si vous y allez, il faut que cela soit pour les objets (qui ne sortiront plus d’Égypte une fois que l’expo itinérante aura achevé son tour du monde) et non pour le propos. La scénographie tient plus ou moins compte de l’affluence des visiteurs (le grand public n’a jamais si bien porté son nom) : les objets sont exposés dans des vitrines autour desquelles on peut tourner ; les cartels, répétés de deux côtés ; et des textes plus généraux, plus ou moins inspirés, installés au-dessus en hauteur. Reste que les myopes ne doivent pas oublier leurs lunettes, parce que le corps de police n’est pas bien grand ; et qu’il faut parfois jouer au paléontologue lorsque l’espacement entre les mots est si réduit qu’on a l’impression de se trouver face à une stèle latine. Je serais curieuse de voir ce que l’expo donne à l’étranger, pour confirmer ou infirmer cette impression que c’est globalement bien conçu, mais pas hyper bien adapté…