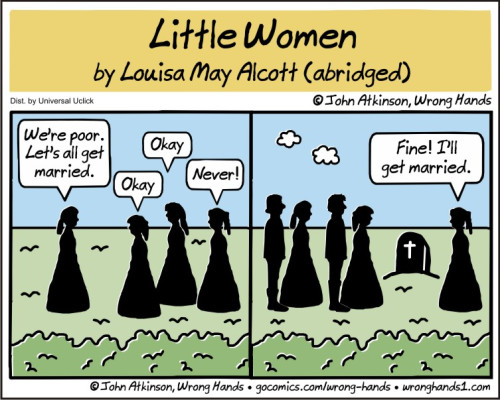Je suis allée voir Les Enfants du temps à l’aveugle, simplement parce que j’avais aimé Your name, le précédent animé de Makoto Shinkai. En voyant la traduction anglaise au générique d’introduction, Weathering with you, je me suis aperçue que j’avais postulé un temps chronologique, non météorologique. Au générique de fin, je me suis rendue compte qu’on pouvait carrément passer de météorologique à climatique.
Il faut bien arriver aux trois quarts du film, pourtant, pour que la thématique s’impose en tant que telle ; on n’en a pas vraiment conscience auparavant, reléguée en arrière-plan comme dans les limbes de l’inconscient. C’est probablement ce qui fait des Enfants du temps une belle fable poétique, loin d’un film à thèse voire à charge. Le film baigne dans le fantastique (Hina se découvre le pouvoir de faire advenir le soleil d’une simple prière), avec tout ce que cela comporte d’ambiguïté et de doute (est-ce un don, Hina était-elle réellement une fille-soleil, ou est-ce un racontar de voyante ?). L’invention est joliement inscrite dans la tradition japonaise, avec l’invention de peintures pleines de dragons et de prophéties anciennes : faire la pluie et le beau temps a un prix, bien différent de celui qu’elle facture aux Tokyoïtes lassés de la pluie – une mort précoce. Tout ceci est amené subtilement, car bien loin des préoccupations de Hodaka, le héros à travers les yeux duquel on tombe amoureux d’Hina, un jeune garçon fugueur qui cherche un petit boulot pour pouvoir manger. Sans qu’on s’en rende compte, pourtant, le dilemme se met en place : sauver Hina ou le temps qui, suite à ses interventions, s’est déréglé et engloutit peu à peu Tokyo sous l’eau ? (Cela m’a fait un drôle d’effet de reconnaître la boucle routière du port de la ville, endroit sans intérêt où Palpatine m’avait trainée, et qui se part rétrospectivement d’une certaine magie, de se retrouver là dessinée.)

Soudain, le dérèglement climatique n’est plus une affaire de profit (même si les ados ont eu leur part de yens), mais de temporalité, de place où chercher la joie : dans la possibilité d’un avenir pour tous ou dans la proximité d’un être aimé qu’on se refuse à laisser partir, mais dont on ne pourra sécher les larmes sous la pluie incessante ? A différer le chagrin, on se met même à trouver un certain charme aux ruines, à Tokyo-Atlantide en devenir. A se rappeler qu’il s’agissait à l’origine d’une baie, que l’essentiel était sous l’eau il y a des centaines d’années de cela, on se cherche finalement moins des excuses qu’on ne se laisse envahir par le sentiment de la fin – celle qui nous attend comme individus, quoi que l’on fasse ou que l’on ne fasse pas pour ceux qui nous survivront. Ce n’est pas vraiment se décourager, baisser les bras ou se renfermer dans un égoïsme tel que le monde périra avec moi ; c’est avoir la conscience aiguë, soudain, de sa fragilité, et se laisser fasciner par le vertige de ce qui se découvre d’une beauté inédite d’être sur le point de disparaître.
Cette anti-apocalypse nous fait renouer avec le temps long, immense, inhumain, le temps d’un monde qui était là bien avant nous et nous survivra, avec d’autres formes de vie pour lesquelles nous n’aurons été qu’un maillon. Et la beauté alors, la fin même s’offre comme consolation. Si le monde que l’on a connu doit disparaître, on peut bien disparaître avec lui.
C’est quelque chose de cet ordre, que j’avais déjà éprouvé à la lecture de Saison brune, extraordinaire roman graphique qui détaille les mécanismes du réchauffement climatique et de nos réactions (ou absences de) historico-sociales mais aussi individuelles. Le panique naissante, d’abord mise en sourdine par l’apaisement que procure la compréhension rationnelle, s’était épanouie jusqu’à disparaître dans cette même brume, de calme après la tempête, d’être qui a compris qu’il allait mourir et décidé de vivre sans se débattre dans l’espoir, le sale espoir. Et c’est calme comme après la tempête, une tempête qui aurait presque tout emporté sur son passage et ne nous aurait plus laissé qu’une vague tristesse d’une immense beauté.
Et nous voilà bien loin d’où l’on pensait être mené, bien loin de la thématique que le film s’est gardé d’énoncer d’emblée, et au coeur du sujet, de l’homme en proie à sa mortalité, qui la voit reflétée dans un environnement qu’il a détruit en tentant de le maîtriser. Qui ne préférerait pas alors s’accrocher au parapluie jaune du petit frère d’Hina ? à toutes les histoires qu’on peut se raconter, à soi ou au cinéma ? et faire la pluie et le beau temps comme on fait l’amour, moi avec toi ?