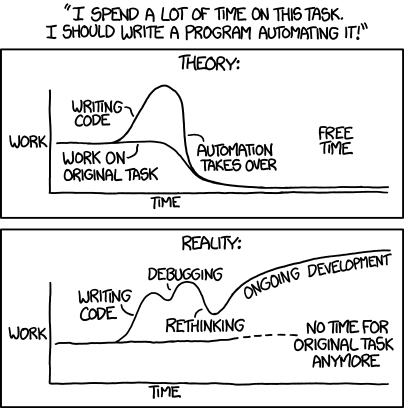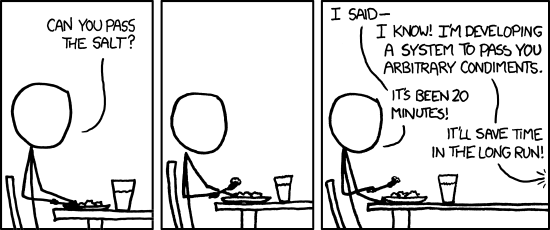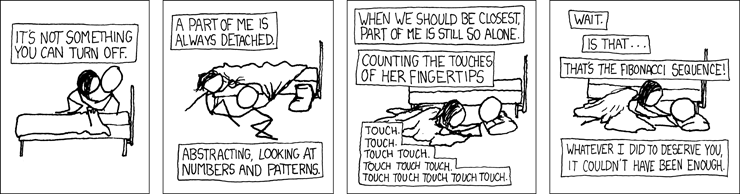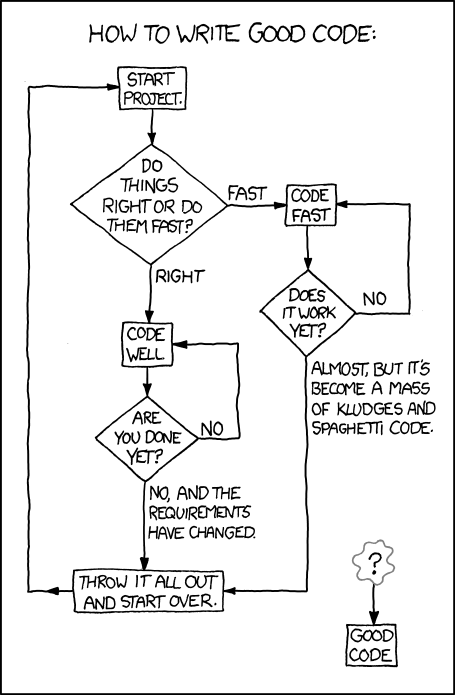Voilà un déplacement cavalier auquel je ne m’attendais pas : lire l’essai d’un romancier développeur et me retrouver à découvrir tout un pan de philosophie et de critique littéraire indienne. Deux pas en avant, un de côté. Ce pas de côté m’est d’autant plus précieux que je ne serais pas allée de moi-même me renseigner sur le sujet. Car l’Inde n’est pas un pays qui m’attire – euphémisme ; j’aurais peut-être même une vague répulsion pour ce qui m’apparaît comme grouillant de sens insaisissables. Mais là, par ce biais littéraire, l’étrangeté me paraît soudain familière et le familier, revu à travers ce nouveau prisme, un peu étrange. C’est fascinant de voir comment une autre culture a traduit les émotions esthétiques ; on est renvoyé à la part flottante, troublante, de ce que l’on a figé par des termes devenus commun – comme si mettre un mot sur la catharsis, par exemple, nous dispensait de l’éprouver.
Petite plongée au cœur de la poétique indienne (avec beaucoup de citation, car je ne me sens parfois pas assez à l’aise avec les termes et les nuances impliquées ne serait-ce que pour les paraphraser.)
Les réverbérations du sens
Aux modes de signification que sont la dénotation et la connotation, le théoriste Anandavardhana1 ajoute la suggestion (dhvani), pour prendre en compte la spécificité du langage poétique, qui se réverbère, créé des résonances : « Dhvani derives from dhvan, ‘to reverberate’ ; dhvani poetry therefore causes an endless resonances within the reader » (p. 109). Cela devrait parler aux lecteurs de Baudelaire, habitués à déambuler dans des forêts de symboles. Ou aux amateurs de Dali et de L’Énigme sans fin, tableau où la perception d’un objet défait celle d’un autre, qui ne cesse pourtant d’être là, les multiples visions ne cessant d’entrer en résonance les unes avec les autres.
L’émotion esthétique ou rasa
Ce que causent ces réverbérations infinies chez le lecteur, c’est le rasa. Vikram Chandra insiste particulièrement là-dessus : le rasa n’est pas l’émotion, mais « the aestheticized satisfaction or ‘sentiment’ of tasting artificially induced emotions. » (p. 112) La différence qu’il y a entre l’émotion et le rasa, c’est par exemple la différence qu’il y a entre la peine et le pathétique, ou entre le désir et l’érotisme. J’aurais bien aimé que celui-là soit davantage creusé ; cela suppose un art érotique qui ne soit pas pornographique ou qui, du moins, n’ait pas pour fonction première d’exciter, non ? Si ? Enfin bon, évidemment, on enchaîne sur le pathétique : « The rasa is in the tasting of grief, in the relishing of grief, in the reflective cognizing of grief. » (p. 11)
Le spectateur d’un pièce de théâtre est capable de faire l’expérience du rasa parce qu’il ne s’identifie pas de manière personnelle, égoïste, avec la tragédie sur scène (p. 113). Et c’est peut-être là la différence principale qu’il y a avec notre conception de la catharsis, où l’on passe par une première phase d’identification, pour ensuite s’en déprendre, s’en détacher. Le rasa, ajoute Vikram Chandra, passe par un état d’objectivité, pas par une subjectivité accrue : « During the experience of rasa, according to Abhinavagupta, ‘what is enjoyed is consciousness itself’. » (p. 151) La perception du rasa dépend de l’oeuvre mais aussi beaucoup des capacités et de l’ouverture de l’auditeur/spectateur.
Les différentes tonalités
On dénombre 8 rasas en tout : the comic, the wrathful, the heroic, the terrible, the disgusting, the wonderful, the pathos, the erotic (auquel on en ajoute parfois un neuvième, the peaceful, qui viendrait de la contemplation du détachement chez le personnage). La coexistence des rasa n’est pas vue comme un affaiblissement du rasa principal, mais au contraire comme un affermissement. ; il est renforcé par le contraste. « This is why the Aristotelian unities of British and American films seemed so alien to me when I watched them as a child. » (p. 162)
Là où cela devient intéressant, c’est que le rasa s’inclut dans une certaine conception du monde. Reprenez votre souffle, on repart pour une petite plongée dans la philosophie à laquelle s’adosse le rasa…
Tantrisme
Les personnes à qui l’on a présenté les Tantra comme des textes érotiques, nous dit Vikram Chandra, s’ennuient généralement à la lecture. Le sexe n’en occupe qu’une partie seulement, peut-être parce que, contrairement à chez nous, il ne fait pas l’objet d’un rejet ou de fantasmes de stricte régulation. Le sexe n’est pas vu comme quelque chose à éviter sur le chemin vers le salut, mais comme un moteur essentiel dans la quête humaine de l’ultime vérité (p. 170). Dans ce contexte, les cérémonies sexuelles sont surtout « a means of shattering the norms of the normal so that one could know the true, indifferentiated self » (p. 171) (même si bon, certains en ont évidemment profité).
Chiti
D’après les philosophes Pratyabhijna (à vos souhaits), « the absolute origin of all that exists […] is a singular infinite, primordial, undivided consciousness, Chiti, which exists before time and space » (p. 173) J’ai lu ça un matin dans le métro et j’ai frémi : souviens-toi, la physique, le ssssubstrat, susurrait Aristote derrière mon épaule droite ; transsssscccental, s’indignait Kant derrière mon épaule gauche. Heureusement, le métro a freiné et a fait valser tout le monde avant que cela ne vire à la confrontation toonesque de Jerry à auréole et Jerry à trident. J’ai repris ma lecture. Toute la diversité du monde est réunie dans le substrat du Chiti ; « what we think of as our own subjectivity is a wilfully contracted portion of Chiti herself » (p. 174) Rho, y’en a pas un pour rattraper l’autre : Leibnitz, arrête de faire rouler tes monades partout ; on a dit seulement dans le jardin !
Un peu de concentration, que diable ! Apprenez avec moi que l’un des signes de l’existence du Chiti est la reconnaissance de la subjectivité d’autrui, de l’intersubjectivité. Et c’est parce que notre conscience une partie du tout que nous pouvons à la fois nous reconnaître comme des individus limités et comme étant relié au tout. Non, Aristote, ce n’est pas le moment de sortir le principe de non contradiction ; tu vas tout nous ruiner, là. Et Descartes, pour l’amour de Dieu, arrête de trépigner, on sait que tu penses pouvoir prouver Son existence à partir de l’idée d’infini qui nous dépasse ; ce n’est pas le propos, là, on ne cherche pas un truc supérieur pour nous juger et nous écraser mais pour nous y fondre. Ouais, c’est ça, va voir chez les stoïciens si j’y suis.
Reprenons : « The task of the seeker after truth, then, is merely one of recognition : recognition of the nature of the limited self and of that universal self, and recognition that the individual self is Chiti, the macrocosm. You already know you are Chiti, but you have forgotten : ‘I am free because I remember.’ » (p. 175) C’est sur fond de Chtiti que s’ancre le rasa : « Rasa is a recognition, a re-cognition of what you have forgotten, that you are blissful consciousness itself. » (p. 175) La poésie nous rouvre à nous-même, au-delà de nos individualités étriquetées, et nous pouvons alors faire un avec le tout, l’espace d’un bref instant.
Je vous entends déjà râler : tout ça pour un bref instant ? Bah oui, parce que s’unir au tout, c’est aussi disparaître comme moi-individu-individualiste : « Yogi practices didn’t just bring bliss and pleasure, [Tantric practitioner and teacher Paul Muller-Ortega] said. The ‘yogic ordeal’ also made you feel that ‘you are dying’.[…] That is, the ego-self that most of us believe to be our true self must die if the identification with the larger, undivided self is to occur. » (p. 215)
Orient-Occident
Je rigole, je rigole, mais ne croyez pas que je me moque. Rappeler nos philosophes occidentaux est peut-être avant tout un moyen d’éloigner le vertige qui prend lors de la découverte de cette autre conception de l’existence. Car ces conceptions, aussi perchées peuvent-elles sembler – et réservées à une élite de penseurs – changent la façon d’être, d’être soi, d’être au monde. Ce sur quoi Vikram Chandra insiste est merveilleusement résumé, par la négative, par T.S. Eliot, qu’il cite ainsi :
« A good half of the effort of understanding what the Indian philosophers were after – and their subtleties make most of the great European philosophers look like schoolboys – lay in trying to erase from my mind all the categories and kinds of distinction common to European philosophy from the time of the Greeks. [ …] my only hope of really penetrating to the heart of that mystery would lie in forgetting how to think and feel as an American or a European : which, for practical as well as sentimental reasons, I did not wish to do. » (p. 207-208)
Interpellante honnêteté intellectuelle. Et si l’on ne parvenait jamais totalement à comprendre une autre culture, à ressentir dans ses termes, justement parce qu’on ne voulait pas se perdre ?
(Là, j’aurais une transition toute trouvée pour passer à l’essai Nord perdu de Nancy Huston sur l’identité de l’expatrié, mais j’ai encore quelques trucs passionnants tirés du bouquin de Vikram Chandra à partager avec vous. Oui, encore. Personne ne vous oblige à lire. :p)
1 C’est dans des cas comme ceux-là que je suis heureuse d’avoir une mémoire photographique…