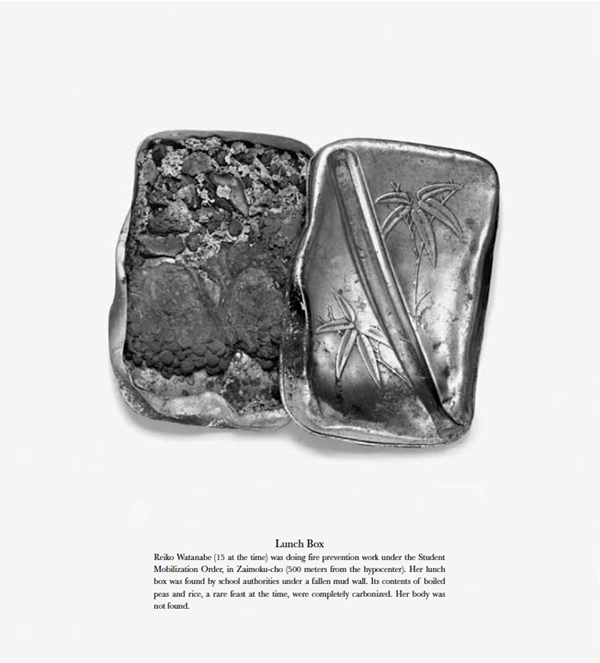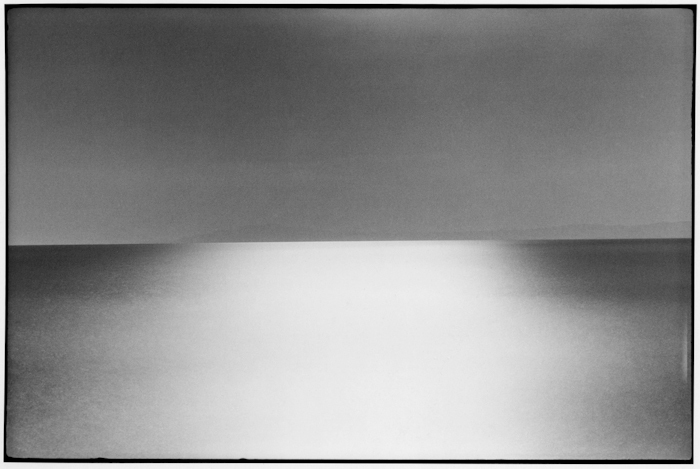9/11, le mémorial
Il n’y a pas à dire, quand il s’agit de mise en scène, ils sont forts, les ricains. Le monument de 9/11 en est une nouvelle preuve, si besoin était : deux immenses béances dans une esplanade, où chutent des milliers de litres d’eau. On a l’habitude de voir les cascades d’en bas, d’où l’on est plus à même de s’émerveiller d’une puissance qui pourrait nous terrasser ; ici, on les voit d’en haut, mais le sentiment de sécurité se transforme subrepticement en malaise lorsqu’on remarque la seconde cascade où disparaît l’eau : un trou noir qui reconduit sans fin l’effondrement des tours, dans un curieux mélange de fracas et de silence. On n’a pas très envie de s’attarder, et pas forcément uniquement parce qu’on a vite fait le tour des pools. (Il faisait beau, nous avons zappé le musée associé et eu assez à faire, ensuite, avec les institutions culturelles traditionnelles.)
Le Guggenheim et sa galerie en hélice
Surprise : le bâtiment est bien plus petit que ce à quoi je m’attendais. Mais sa photogénie ne déçoit pas. C’est même l’attraction principale, au détriment de ses collections, pour le moins, euh… palaisdeTokyoesques ? J’adore l’idée de progresser en hélice, l’art à conquérir comme un sommet si l’on part du bas ou à butiner en déambulant tranquillement si l’on part du haut.
Petit tour au Guggenheim, que je verrais bien reconverti en terrain de bobsleigh à roulettes. pic.twitter.com/WVBkzmCOp6
— la souris (@grignotages) April 15, 2018
Côté pratique : y aller sur le créneau Pay as you wish pour éviter de débourser 25 $ (un peu cher quand on vient uniquement pour le bâtiment) et ne pas arriver trop tard, parce que la file d’attente fait le tour du pâté de maison avant même l’ouverture du créneau. Ne faites pas comme nous, prenez l’ascenseur jusqu’au dernier étage dès l’arrivée.
Le MET, Louvre new-yorkais
Le Metropolitan Museum était en rénovation quand j’ai découvert New York ; c’était donc LE musée en priorité sur ma to-visit list. Comme ce Louvre local ne permet pas de tout voir en une seule visite, on s’est rapidement frayé un chemin à travers les salles égyptiennes (en s’attardant sur un merveilleux hall vitré, avec une reproduction d’un temple grandeur nature, plans d’eaux compris :O) pour se diriger vers les collections d’art européen du XIX et XXe siècle. Enfin c’est ce que j’espérais, parce que Palpatine préfère les vieilleries, et on a passé un temps infini certain au milieu de joues roses et de drapés bien peints.
Faut avouer qu'il pète pas mal, ce musée. #MET #NYC pic.twitter.com/DXTECHReki
— la souris (@grignotages) April 16, 2018

Je zappe sans pitié pleins de toiles et signale les tableaux majeurs à Palpatine, qui arrive toujours avec une salle de retard. Que voulez-vous : il est Jacquemart-André ; je suis musée d’Orsay. On se retrouve devant les Vermeer, parce que : la lumière. Je me rends compte que c’est à peu près tout ce qui m’intéresse dans les siècles reculés, et c’est ce qui m’arrête devant certains tableaux, entamant mon désintérêt déclaré : l’éclat lumineux d’un oeil chez Vigée Le Brun, un turban éclairé par Rembrandt, le clair-obscur de La Tour et… oh my God, je ne connaissais pas, mais je crois reconnaître… gros crush pour la jeune femme dessinant de Marie Denise Villers. Ne dirait-on pas une apparition ? Il se pourrait que je commence à reconsidérer mon indifférence ennuyée envers les vieilleries ; quand on saute par-dessus le Grand Siècle emperruqué, on se trouve parfois face à des traits inattendus de modernité. On m’aurait montré la Vue de Tolède sans me dire qu’il s’agissait du Gréco, je l’aurais sans doute datée du XIXe siècle. Après tout, n’est-ce pas justement ce à quoi on reconnaît les maîtres : leur aptitude à ouvrir une brèche par-delà leur époque ? (À ce compte, il faudra me black-lister Rubens.)
Quand on arrive enfin à ma période fétiche, je virevolte parmi les impressionnistes et frémis à chaque toile entrevue dans la salle suivante, mais comment dire ? Je ne parviens pas à observer avec la même intensité ; je vois, et cela m’empêche de regarder. C’est comme si, biberonnée à cette période, je l’avais intégré à ma vision du monde. Il faut bien admettre que les retrouvailles avec Monet-Van Gogh-Degas et consorts, si plaisantes soient-elles, s’avèrent peu revigorantes ; cela ne décrasse pas l’oeil. Les toiles n’encadrent plus qu’un fragment d’une réalité déjà absorbée, et ne se détachent plus individuellement. Ou rarement, car il y a heureusement plein d’exceptions. Des découvertes ou re-découvertes variées au sein du XIXe siècle : Böcklin (je pourrais rester des heures devant l’île des morts – j’imagine que c’est ce qui s’appelle vivre), Maximilien Luce, Sorolla, Bouguereau, Hammershøi (direct envie d’ouvrir un tumblr des peintures de pièces vides, portes et fenêtres aveugles, où on le mettrait aux côtés de Sun in a Empty Room, de Hopper), la Jeanne d’Arc de Jules Bastien-Lepage (forte impression de déjà-vu-à-New York ; je me demande rétrospectivement si, lors de la rénovation du MET, certaines toiles n’avaient pas été exposées au MoMa)… Une découverte surréaliste du XXe, aussi, qu’il me faudra approfondir : Kay Sage. Comme j’ai moyennement envie de passer deux heures supplémentaires à retrouver et insérer tous les tableaux, je vous invite à jeter un oeil au thread Twitter que j’ai fait sur place, avec la plupart de mes coups de coeur (et aussi pas mal d’âneries).
Côté pratique : rendez-vous au MET après un brunch ou un early déjeuner, parce que le musée est immense et la cafétéria hors de prix si vous cherchez à vous restaurer un tant soit peu substantiellement. Prévoyez si possible dans les deux jours qui suivent un créneau pour vous rendre aux Cloisters, auquel le billet du MET donne accès.
Pour grignoter un morceau avant de venir : Pick a bagel avec des parfums de cream cheese assez délirants au 1101 Lexington Avenue (c’est une chaîne).
The Cloisters, extérieurs et excentrés
Autant les vieilleries moyenâgeuses ne sont pas ma tasse de thé (on est quand même très loin du XIXe siècle, là, faut pas pousser mémé dans les orties), autant j’ai un faible avéré pour les cloîtres et leur arches ménageant un clair-obscur dans lequel il fait bon se promener. Encouragée par Melendili, j’ai suivi Palpatine dans son souhait d’amortir le billet du MET en allant visiter The Cloisters.
Les vieilles pierres des Cloisters étaient essentiellement françaises et le musée essentiellement visité par des touristes… français… comme à peu près partout ces jours-ci à New York. #NYC pic.twitter.com/0bjGvEIgqo
— la souris (@grignotages) April 19, 2018
La reconstitution de cloîtres grandeur plus ou moins nature (et la corne de narval plus grande qu’un basketteur) vaut clairement le coup de prendre le métro pendant 40 minutes tout au Nord de Harlem. Le musée est juché en haut d’un parc, pas loin d’un petit belvédère d’où l’on peut admirer les falaises du New Jersey (avec certes un bout d’autoroute en bande-sonore étouffée). Le tout forme une très sympathique balade ; j’ai ajouté le cloître-patio à mes idéaux architecturaux (le bow window paraît désormais simple en comparaison).

Côté pratique : privilégier un jour ensoleillé ou du moins sans pluie, étant donné qu’il faut marcher un bon quart d’heure depuis le métro et que deux des trois cloîtres sont en extérieur.
Pour grignoter un morceau, rendez-vous quasi en face du métro au Broadyke Meat Market (4767 Broadway) pour un bagel custom made (charcuterie et fromages au choix) et de délicieux muffins. Rien que pour l’étiquette suggérant la prononciation du gruyère (gree-hair) et les sayings écrits à la main (It’s not us who are late, so please, don’t rush us), ça vaut le coup .
La Frick, c’est chic
Encore des joues roses, me disais-je à propos de la Frick Collection. Mais JoPrincesse avait insisté. Il faut bien avouer que c’est particulier. Comme dans hôtel particulier : meubles lourds, décoration chargée, moquette feutrée (ai-je déjà marché sur de la moquette dans un autre musée ?). On pourrait y tourner un équivalent américain de Downtown Abbey : tout sent le luxe d’une classe riche et éduquée (goûtant essentiellement les vieilleries, à l’exception de quatre Whistler). Point d’orgue du lieu : le patio avec son bassin et sa verrière.
Côté pratique : repérer le créneau Pay as you wish. L’attente a été assez courte alors que nous nous sommes pointés un peu après le début des festivités.
Ellis Island & le storytelling
La visite d’Ellis Island, chaudement recommandée par Marianne, c’est l’équivalent new-yorkais d’Alcatraz à San Francisco : un lieu-musée auquel on accède par bateau, à visiter l’oreille vissée à l’audioguide. À moins de réserver un hard hat tour, qui donne accès aux parties en ruines de l’île, il n’y a pas énormément de choses à voir, mais la reconstitution narrative est d’une telle richesse que l’on peut y passer des heures, guidé par un ranger (Ellis Island est un parc national) ou par l’audioguide. Les deux ont le chic pour vous faire revivre le parcours d’un immigrant du XIXe siècle, à grand coup de storytelling : appréhension, espoirs, suspens, questions pièges (il fallait montrer sa détermination à trouver du travail, mais ne pas avoir d’emploi réservé… une pratique illicite)…
Le grand hall où les migrants étaient examinés et interrogés. #EllisIsland #NYC pic.twitter.com/cc4aH7ch1h
— la souris (@grignotages) April 20, 2018
La plupart des immigrants passaient tout au plus quelques heures sur l’île (quand on voit qu’il faut aujourd’hui 1h30 pour passer la douane en tant que simple touriste, cela ne paraît pas démentiel);la dramatisation intervient avec les quelques pourcents renvoyés ou retenus sur l’île, le temps de guérir d’une maladie contagieuse dans l’hôpital attenant, de voir son cas jugé dans le tribunal incorporé… ou encore de se marier (les femmes seules n’étaient pas admises, entraînant des mariages arrangés par correspondance !). L’île devient alors un curieux purgatoire, où le statut des immigrants oscille entre celui de détenu (dans la promiscuité, avec des lits en toile superposés) et d’invité (repas offerts, servis avec des couverts en argent).
Non seulement le storytelling rend la visite vivante et plaisante, mais il contribue à une meilleure mémorisation de ce morceau d’histoire, s’il est vrai qu’on se souvient mieux de ce qui s’accompagne d’un ressenti émotionnel – ce qui marque, quoi. Évidemment, l’immersion full feeling a l’inconvénient de ses avantages : elle relègue au second plan la mise en perspective historique, remisée dans une partie du musée qu’on dirait réservée aux scolaires tant on se croirait dans un manuel… avec une dimension politique proche de l’endoctrinement pour la période la plus récente et polémique. L’heure de fermeture approche ; on traverse cette partie du musée au pas de course.
Idem pour le dernier étage, consacré à l’histoire du lieu (par opposition à la portion d’Histoire qu’il a abritée) : des maquettes reconstituant l’agrandissement de l’île et les constructions des différents bâtiments, les effets personnels de familles de diverses origines… ainsi que des meubles et des objets récupérés avant la rénovation du bâtiment principal, tombé en ruine après qu’on ait cessé de l’utiliser. À voir le carrelage régulier du grand hall, on peine à croire qu’un arbre avait poussé en plein milieu… J’aurais aimé passer davantage de temps devant les photographies et les objets sauvés de ce Titanic temporel – un contrepoint à la reconstitution qui, à le faire revivre comme au présent, abolit d’une certaine manière le temps passé. J’ai beau savoir que là ne réside pas l’enjeu historique, les ruines, et celles-ci relativement récentes, me fascinent… comme si nous apercevions, vivants, le temps où nous ne serons nous-même plus que souvenir.
Très envie de revoir Brooklyn…
Côté pratique : zapper la statue de la Liberté, que l’on voit bien depuis le ferry, pour passer plus de temps dans le musée. Entre deux sections, posez-vous à la cafétéria : l’offre est insipide, mais la salle reconstitue la salle à manger de l’époque des migrants (si j’ai bien compris – j’étais HS).