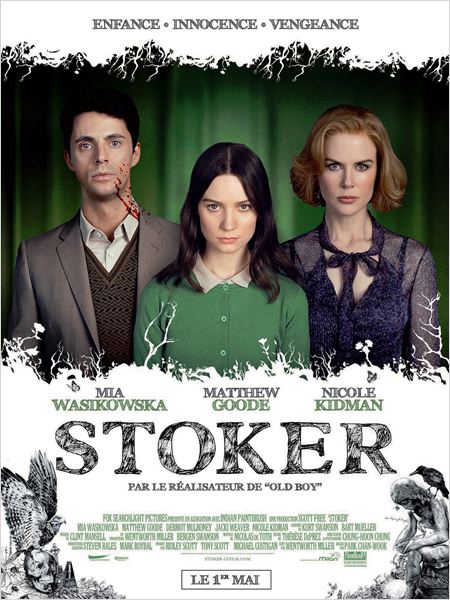Des volutes d’encre de Chine dans l’eau, comme les volutes de fumée d’In the mood for love le raffinement de Wong Kar-Wai, allant jusqu’au maniérisme, est affiché dès le générique de The Grandmaster. Et la première scène, que l’on devine être un combat, sans comprendre qui attaque qui ni comment (et certainement pas pourquoi), est gorgée de cette sensualité qui veut sentir dans le détail, sentir la matière, jusqu’au plus petit élément qui le constitue, sans en perdre une goutte. Elles tombent donc au ralentit, s’éclatent et rebondissent lorsqu’elle ne sont pas fendues par une épée – chorégraphie miniature du combat qui les jaillir.

Macro et ralenti extrêmes font apparaître le grain de la peau, la dilatation de l’oeil, le flottement des cheveux, le tourbillonnement des flocons de neige, la chute des pétales de fleur et des hommes. À tout moment le temps peut être dilaté et le présent vécu comme un souvenir, repassé au ralenti pour le retenir, se repaître de ce qui est déjà passé. Cela ne rend pas le film lent mais presque trop rapide au contraire : l’image est si riche qu’on n’a jamais vraiment le temps de l’absorber, d’en saisir tout ce qui mérite d’être apprécié. Face à cette saturation des sens, seule la contemplation peut sauver de l’irritation. Le visage de Zhang Ziyi y invite, si lisse qu’il aimante le regard qui, ne trouvant aucun point d’accroche, ne peut que passer et repasser sur ce visage et s’étonner de ce qu’une telle détermination se dégage de son mutisme.
Gong Er, la femme qu’elle incarne, est en effet dépositaire d’une partie de l’héritage de son père, maître de kung-fu. Elle n’hésite pas à affronter l’homme devant lequel il s’est incliné ni à le venger lorsque son disciple le trahit – une femme forte, ce qui la rend terriblement belle. Belle comme la technique qu’on lui a transmise : les 64 mains ; terrible comme l’issue, mortelle, de cet enchaînement. Petit à petit, à mesure que sont esquissés les tempéraments, les styles, les écoles des maîtres de kung-fu, on comprend qu’il ne s’agit moins de techniques de combat que d’un style et d’une discipline de vie. Le geste n’est plus seulement un mouvement, il a une portée éthique et esthétique – un art, martial, comme il en existe un autre, en Occident, chorégraphique.
Bien que la dimension éthique ne soit que très lointainement présente dans la danse, c’est ce parallèle qui m’a permis d’entrer dans cet univers : la discipline repose sur un apprentissage de règles, codifiées, mais surtout un apprentissage de soi, de maîtrise de soi, qui va jusqu’au laisser aller (savoir s’incliner devant l’adversaire). J’y retrouve cette puissance très particulière, la puissance qui naît de l’extrême concentration. Pensez, pour les balletomanes, à ces rares danseurs qui fascinent davantage par un simple geste, voire par leur immobilité, que par les plus grandes prouesses techniques. L’analogie a ses limites mais permet de comprendre que la chorégraphie des affrontements n’est pas seulement un ornement : l’esthétisme qui s’ajoute à l’efficacité est un moyen de montrer qu’on affronte moins son adversaire que l’on ne se mesure à lui, pour s’éprouver soi-même. Le niveau de maîtrise supérieur, qui passe par la joute verbale, n’est plus guère filmique et ne se produit qu’une seule fois, entre le père de Gong Er et Ip Man.

À partir de là, je commence à comprendre les visages impassibles, leur pudeur, l’économie de la parole – toutes choses qui avaient plutôt tendance à m’exaspérer jusque-là, me donnant envie de les prendre par les épaules pour les secouer comme des pruniers. Je ne dois manifestement pas être la seule Occidentale à penser comme ça, car les deux acteurs principaux (ou que l’on décide de rendre principaux en extrayant la non-histoire d’amour de l’Histoire qu’on nous conte) ont des visages beaucoup plus expressifs que les autres, où affleurent toutes sortes de « sentiments ténus ». Il y a une beauté de l’infime, étouffante pour certains, que je retrouve jusque dans les traits fatigués d’Ip Man – Tony Leung. C’est ce qui m’a retenue dans ce film, plus encore que les questions d’héritage, de filiation, de tradition, qui irriguent pourtant toute l’histoire – et dans lesquelles, les gros plans n’aidant pas à saisir une vision d’ensemble, je me suis un peu perdue. Il faut reconnaître que le film, réalisé sur une période de dix ans, est un peu chaotique (confondre deux personnages n’a certainement pas aidé, je l’avoue). Cela dit, si l’histoire est quelque peu décousue c’est aussi qu’il n’y a en définitive pas vraiment dans The Grandmaster – je veux dire autre que l’Histoire ou que les histoires qui auraient pu se passer.
Il y a des vies que l’on s’est appliqué à vivre selon la discipline que l’on s’est imposée, par laquelle on s’est construit – une chose que nous ne sommes pas vraiment à même de comprendre sous nos latitudes, qui aurons tendances à y voir des destins brisés. Apparemment, c’est pour cela que Wong Kar-Wai a tourné deux fins : l’une à destination du public local et l’autre à destination du public occidental, plus conclusive. Je suis prête à parier qu’il s’agit de la discussion entre Gong Er et Ip Man, que l’on nous aura offert comme consolation à ce que l’on n’est guère capable de voir que comme des amours contrariées, alors qu’il s’agit aussi et avant tout d’un choix, d’une éthique de vie. Les quelques scènes-impasses qui introduisent la Lame, un autre maître de kung-fu, sans jamais l’incorporer au récit, improbables pour les lecteurs* que nous sommes, sont là pour nous le rappeler : il s’agit de l’histoire de quelques vies remarquables portraiturées, pas d’une histoire romanesque au sens où nous l’entendons (même si l’on peut évidemment l’y trouver). Ce parti-pris narratif, selon lequel l’histoire ne vaut pas en vue de son déroulement mais pour elle-même, correspond à un art de vivre, résumé par une citation de Bruce Lee, juste avant le générique : A man does not live for, he simply lives.

[La scène près du train a un petit côté grandiose à la Anna Karénine…]
Pas de conflits de grandes causes, pas de dilemmes cornéliens, dans ce cas : des choix qui s’imposent et avec lesquels il faut vivre. Sans regrets, la vie serait dérisoire. Je ne suis normalement pas adepte de ces phrases-dictons que les personnages de films chinois improvisent avec dix syllabes, une fleur et une métaphore ; les devinettes censées révéler le sens profond des choses me laissent dubitatives. Mais cette parole de Gong Er lors de sa dernière entrevue avec Ip man m’a frappée : les regrets ne signifient pas que l’on aurait dû agir autrement (ce seraient des remords) – ils sont seulement le souvenir de ce que les choses n’ont pas toutes eu une valeur égale pour nous, l’assurance de ce que l’on n’a pas traversé la vie dans l’indifférence. Cela a quelque chose de libérateur, vous ne trouvez pas ?
* Dans une interview, Wong Kar Waï parle des romans d’arts martiaux chinois (dont les chapitres fonctionnent indépendamment les uns les autres comme des portraits juxtaposés), de sa volonté de s’en inspirer mais de l’incompréhension que cela aurait suscité en Occident où la conception traditionnelle de l’intrigue exige un fil conducteur. Cela me fait rire lorsque je pense à Kundera et à sa forme romanesque contrapunctique, une innovation… européenne, en fin de compte.