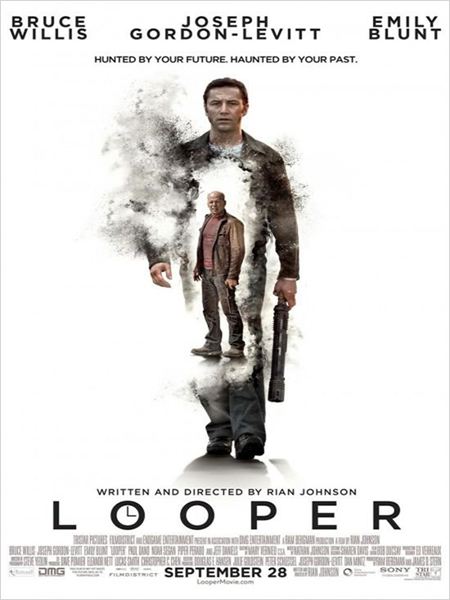In the middle, somewhat elevated : une paire de cerises dorées, éclat métallique que je n’avais jamais vu sur les vidéos. Dessous : my piece of cake. Des pas précis, arrêtés nets, enchaînés à toute vitesse, brusquement relâchés sur un accès de nonchalance et aussitôt repris sous un angle improbable, hanche en avant ou attitude décalée. Avec leur justaucorps bleu canard et les collants noirs qui dessinent un slip plus foncé par-dessus, les danseuses s’attaquent à des équilibres qu’il ne s’agit pas de retenir mais de repousser, pour les désaxer et étirer toujours davantage le déséquilibre. Les suspensions et les arrêts brusques n’entravent jamais la vitesse de l’ensemble, lui donnent au contraire un relief saisissant. Les déhanchés n’en sont que plus sensuels, tout comme les torses ondulants, répercussions brèves et intenses des coups portés par les jambes. Dès que le mouvement menace de s’alanguir, il est contrecarré par un geste rapide qui entraîne le corps dans une nouvelle direction. Il n’y a pas plus sexy que cet oxymore dansé, aussi extrême dans sa force que dans sa suavité. A ce point, la virtuosité devient insolente : on vous défie de ne pas être séduit. Je ne résiste pas deux secondes : ce mélange d’autorité et d’indifférence me fait toujours de l’effet. Sans compter que les a-coups de la musique nous précipitent dans la bataille : on se baisse d’un épaulement pour éviter une jambe, on contracte les abdos pour retarder un déséquilibre et on donne un coup de tête pour arrêter un tour. Explosion, chuintement et claquement assourdissant, la puissance de suggestion du train n’a jamais été aussi violente que dans ces éclats sonores, triturés électroniquement au même rythme que les corps des danseurs.
Ces derniers s’éclatent. Côté garçons, je renie sans scrupule Audric Bezard pour Axel Ibot, qui déménage. Le style convient particulièrement bien à Laurène Lévy dont l’immense buste amplifie le mouvement et ses secousses à merveille. Il ne convient en revanche pas du tout aux danseuses que j’ai pu voir dans une seconde distribution : les petits modèles mettent à profit leur centre de gravité plus bas pour foncer comme des bolides et camper des équilibres inébranlables ; c’est techniquement irréprochable mais on perd tout ce qui fait la saveur de la chose, à savoir l’avant-goût du danger. Seule l’incertitude donne cette assurance désinvolte, si sexy, à ceux qui se risquent dans d’improbables déséquilibres. Terreur et pas de pitié pour le spectateur qui doit continuer de frémir après avoir sursauté au crash sonore de l’ouverture.
Le souvenir émerveillé que j’avais d’O Zlozony / o composite est resté un souvenir : Aurélie Dupont, alors stellaire, a comme perdu une partie de son aura et l’étoile, réduite à sa matière, est devenue dure comme la pierre. J’espère qu’elle ne nous couve pas une naine blanche… Entourée d’une part par Jérémie Bélingard, son compagnon à la ville, et Nicolas Leriche, son partenaire de scène, elle me donne l’impression de conclure un moment de sa vie de danseuse et d’interdire toute nostalgie au spectateur. L’émotion ne ressurgit que lorsque les deux hommes se retrouvent seuls en scène, allongés par terre, tournant lentement autour de leur axe – planètes foetales qui accomplissent paisiblement leur révolution, sous les chuchotements d’astres lointains comme le souvenir d’une berceuse.
Isabelle Ciaravola, comme en apesanteur, me fait retrouver en partie la sensation de sérénité et d’émerveillement que j’avais eue la première fois – même si Jérémie Bélingard, les pieds sur terre, ne semble toujours pas appartenir à la même galaxie que ses deux partenaires ; même si j’étais venue pour voir Muriel Zusperreguy, que j’imagine très bien dans ce rôle après sa Lune simple et sensuelle dans Caligula (si l’Opéra pouvait arrêter de changer les distributions à la dernière minute sans prévenir, ça serait sympa).
In the middle m’a enthousiasmé au possible ; Woundwork 1 m’a émue. Découverte préméditée dans un cas, totalement insoupçonné dans l’autre. La jupette rose, un brin étrange sur Isabelle Ciaravola (1re distribution) et Marie-Agnès Gillot (2nde distribution), dont les bustes sont un peu plus larges, mais parfaitement assortie par son asymétrie au chignon banane d’Eleonora Abbagnato est bien la seule chose qui ne soit pas totalement harmonieuse. Les deux couples, qui ne s’alignent qu’au tout début et à la toute fin, évoluent chacun à leur rythme, chacun avec leur grammaire, forgée dans l’intimité d’une relation que j’imagine nourrie par des années d’écoute et d’entente. C’est d’une grande beauté ; d’une grande tristesse, aussi. Comme si une telle maturité artistique ne pouvait être qu’éphémère. Je regrette soudain de penser qu’il seront la prochaine génération à devoir quitter la scène. Qu’on nomme Eleonora Abbagnato avant qu’elle ne s’éloigne à nouveau ! L’Opéra manque cruellement d’une blonde solaire dans ses constellations et elle est tellement belle en scène… Je n’ai pas réussi à détacher les yeux du couple qu’elle formait avec Nicolas Le Riche.
Deux visionnages n’ont pas été de trop pour apprécier tout le foisonnement de Pas./Parts : des pas en veux-tu en voilà et des morceaux qui enchaînent en laissant les danseurs finir au son d’une nouvelle musique les mouvements auxquels les avait entraînés la précédente – décalage qui rappelle le flottement d’une piste de danse lorsque le DJ passe d’une chanson à l’autre. Justaucorps bicolores en recto-verso, T-shirts fushia ou noirs à paillettes, la couleur se trouve aussi dans les éclairages, froids ou chauds selon que retentit une sirène de paquebot ou qu’est chuchoté, on a peine à y croire, un chachacha, bientôt confirmé par un rythme endiablé. Une grande fête pour terminer la soirée.