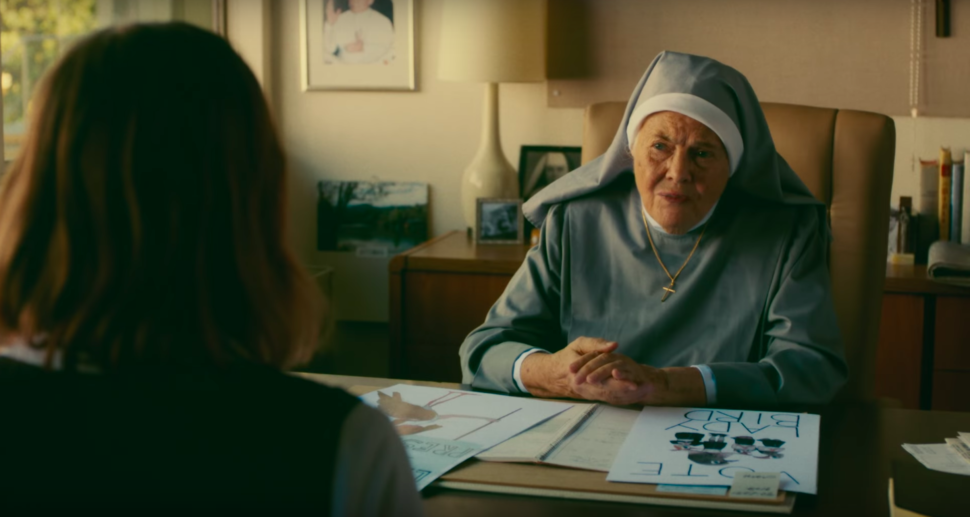Cousu de fil blanc, Phantom Thread ? Certainement. Un couturier de renom qui fait d’une serveuse délicieusement maladroite sa nouvelle maîtresse et sa muse, dans le Londres des années 1950 et dans un film de facture classique, cela flaire l’intrigue prêt-à-porter. C’est qu’on a vite fait de ne pas remarquer que le tissu narratif cousu de fil blanc est lui-même blanc. Parfois, exhiber est le meilleur moyen de cacher – quoi ? une relation étrange, quoique peut-être pas tant que ça, entre un créateur qui dicte la conduite de son monde et une jeune femme aussi douce d’abord que déterminée : elle lui sert certes de modèle pour créer de nouvelles robes (passablement laides), mais c’est lui qui finira rhabillé pour l’hiver.
La scène lors de laquelle laquelle Reynolds tourne autour d’Alma pour lui faire essayer le bâti d’une première robe résume assez bien la relation qui se met en place, entre séduction et vexation : elle est plantée là, future muse pour l’instant en petite tenue face à un homme qui l’admire autant qu’il l’objective – la mécanique du désir, dans son ambivalence. À l’essayage, dont la charge sensuelle n’a rien à envier à un premier déshabillage, succède la prise de mesure, soudain vexatoire : la soeur pète-sec du couturier débarque, et note la mine sévère les chiffres que son frère énumère et commente, sans qu’on puisse plus démêler le compliment de l’humiliation. Vous n’avez pas de poitrine, remarque Reynolds sur un ton qui conduit Alma à s’excuser. Reynolds la reprend : it’s perfect ; it’s my job to give you some. If I wish to. Ce n’est plus Pygmalion qui parle, mais un monarque despotique : si tel est mon bon plaisir. Le détail résume à lui seul la conduite du créateur, contre laquelle la muse va mine de rien résister – d’autant plus qu’elle semblera s’y soumettre.
Tout l’intérêt du film réside dans le bras de fer qui s’engage entre Reynolds (séduisant-agaçant Daniel Day-Lewis) et Alma (Vicky Krieps), beaucoup moins docile qu’on l’aurait cru. Sommée de s’inscrire dans la vie de Reynolds sans rien déranger de sa routine de célibataire égocentrique, Alma s’adapte pour mieux résister : se lever en pleine nuit pour qu’il découpe ses tissus sur elle ; beurrer ses tartines dans le silence le plus absolu pour ne pas déranger la routine du maître, qui ne saurait se remettre d’une journée mal emmanchée ; dormir ou attendre dans sa chambre à elle sans jamais toquer à la sienne… Ama intègre les codes de la maison et gagne le respect de la soeur, Cyril, qui défend son frère contre les perturbations extérieures autant que contre lui-même. Elle intègre les codes… mais ne se résigne pas à l’attention intermittente de Reynolds, qui l’agace de plus en plus à mesure que le créateur la délaisse, après l’avoir comme un bel objet ajoutée à son intérieur. Puisque Reynolds méprise le compromis, elle se met à exiger – des caprices d’enfant aux yeux de Reynolds, qui oublie qu’il ne lui laisse guère le choix en l’infantilisant comme il le fait.
[SPOILER ALERT – ne lisez plus au-delà si vous comptez voir le film]
C’est là qu’intervient le twist du film, et que se dévoile le caractère twisted d’Alma : remarquant que le créateur baisse la garde de la forteresse qu’il s’est bâti et redécouvre la tendresse dans ses moments de faiblesse, lorsqu’il se repose après ses défilés, elle provoque délibérément cette faiblesse… en l’empoisonnant. Elle prend alors soin de lui avec le sadisme et la tendresse d’une mère atteinte du syndrome de Münchhausen par procuration. Reynolds, qui ne jure que par sa mère depuis le début du film, développe enfin la reconnaissance tant attendue.
Les champignons vénéneux fonctionnent comme un filtre d’amour : à merveille, mais avec une efficacité limitée dans le temps. Qu’à cela ne tienne, il suffit de recommencer : sauf que cette fois, Reynolds comprend ce qu’Alma trame… et rentre dans son jeu. C’est là que les critiques se mettent à parler de perversion… et que le film devient jubilatoire, quand au lieu de tout dérégler, la vengeance rétablit un drôle d’équilibre : pas de compromis, mais deux fortes têtes qui se la tiennent, dans un bras de fer sans cesse renouvelé où chacun gagne sitôt qu’il perd, la relation ne se poursuivant que parce que chacun obtient à tour de rôle ce qu’il veut.
J’ai l’impression de comprendre étrangement bien ce couple où ni l’un ni l’autre ne lâche rien, et s’admirant pour cela, ne se lâchent pas. Amoureuse exigeante, je suis Alma ; tyran domestique, je suis Reynolds (il faut l’entendre commander son petit-déjeuner au restaurant, du thé si c’est du lapsang, de la confiture avec les scones mais pas de fraise…). Je ne sais pas si c’est d’être passée par des périodes où j’étais un peu frustrée d’essayer vainement de récupérer l’attention d’un Palpatine lui aussi obnubilé par son travail, mais j’ai trouvé absolument jouissive la scène où Alma beurre et croque bruyamment ses tartines, à en faire grimacer Reynolds. Loin d’adopter un ton dramatique lorsqu’Alma se met à jouer avec la vie de Reynolds, le réalisateur choisit l’humour et s’y tient, donnant à son film un ton inimitable… ou presque, puisqu’il me rappelle étrangement celui de Monsieur & Madame Adelman, une tout autre histoire, très similaire, où la victime se paye si bien sur la bête qu’elle en devient à son tour le bourreau consentant. Grinçant et très, très réussi.
 The Shape of Water est un nouvel avatar du monstre dont un regard bienveillant saura voir l’humanité, envers et contre tous. Le titre m’avait fait imaginer une créature polymorphe, qui prendrait la forme de ce qui la contenait, mais il s’agit en réalité d’une métaphore pour l’omniprésence de l’amour, débordant la présence de la personne qui l’inspire — la créature, elle, est une espèce de poisson-lézard-bipède, qui suscite la curiosité puis l’attachement d’Elisa, femme de ménage sur la base militaire aérospatiale où la créature a été traînée comme asset.
The Shape of Water est un nouvel avatar du monstre dont un regard bienveillant saura voir l’humanité, envers et contre tous. Le titre m’avait fait imaginer une créature polymorphe, qui prendrait la forme de ce qui la contenait, mais il s’agit en réalité d’une métaphore pour l’omniprésence de l’amour, débordant la présence de la personne qui l’inspire — la créature, elle, est une espèce de poisson-lézard-bipède, qui suscite la curiosité puis l’attachement d’Elisa, femme de ménage sur la base militaire aérospatiale où la créature a été traînée comme asset.