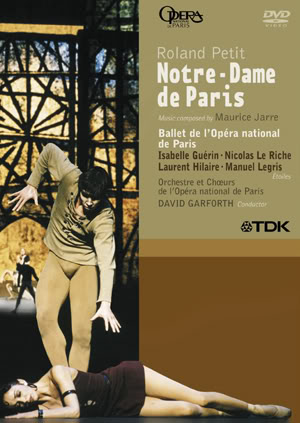Jeudi 8 juillet, à Versailles, une fois n’est pas coutume (ni deux, mais c’est déjà mieux). Après un frichti à la maison, Melendili, le Teckel et moi n’avons qu’à descendre à pied l’avenue de Paris pour assister à un miracle autrement plus réjouissant que de marcher sur les eaux : danser sur un bassin. J’y avais vu le Lac des cygnes par l’ENB (que je vais revoir en août, youpi!), et même si le thème des ballets chorégraphiés par l’auteur du Parc n’a cette fois rien d’aquatique, celui du château fait toujours son effet. Deuxième catégorie, nous avons l’excellente surprise de nous trouver très bien placées (limitrophes de la première catégorie, je dirais), au cinquième rang, un peu après le coin du côté cour, sans colonne ni pendillon : royal ! Les gradins mettent un peu de temps à se remplir, mais un quart d’heure plus tard, passé à discuter des mérites respectifs des ouvreurs et à se demander ce que les poupées chiffon de mariée font sur scène (« vraiment des poupées ? Ah, oui, elles n’ont pas de mains, ça aurait du me mettre sur la voie »), le spectacle peut commencer.
De sacrées Noces
Le pièce est presque aussi vieille que moi, autant dire vieille comme le monde. Et la tradition qu’elle met en scène, ancestrale. L’homme prend une femme pour épouse. Il ne s’agit pas de mariage, la femme n’épouse pas l’homme, elle n’est qu’épousée, étouffée. Elle est prise, pour femme peut-être, enlevée, capturée, arrachée à elle-même. Il la prend, il l’enlève, l’élève dans les airs, la secoue comme auparavant la poupée de chiffon. Elle a d’autant plus l’air d’un pantin désarticulé qu’elle n’est pas la seule, qu’elle se retrouve dans cinq couples. Les dix danseurs décuplent la force d’une histoire que leur nombre et leur semblance empêchent d’être personnelle. C’est une affaire de tradition, plus terrible d’être acceptée. Un « rapt consenti » : les filles sont enlevées, elles y consentent mais ne résistent pas moins ; et c’est cette tension qui fait toute la force de cette danse déchirante, sur une musique de chants qui tiennent autant du cri que de la plainte.

Petit à petit, on comprend pourquoi les jeux de séduction propres à chaque couple, autour d’un banc, n’ont rien d’attendrissant. On étouffe avec ces danseuses qui s’enferment dans un enchaînement de gestes secs sans cesse répété : le corps plié en deux, tête baissée, bras arrondis au-dessus de la tête comme un animal qui pourtant ne fonce sur rien, ne peut que se cabrer dans un saut qui le fait se replier sur lui-même ; pas arrêté, mains derrière la tête, sur la nuque, coudes ouverts qui se ferment brusquement contre le visage ; le bras qui lâche et s’oublie en un mouvement pendulaire, mécanique enrayée ; passage en première effacée, tête lâchée sur le côté, comme si elle venait de prendre une gifle (à ceci près que c’est le corps qui a pivoté).

Les couples sont rudes et lorsque les hommes saisissent les femmes et les font tomber à la renverse sur leur bras, elles ne se cambrent pas comme des danseuses de tango mais, refusant de jouer la sensualité contre la sexualité et d’être prises éprises, même si elles ne peuvent échapper à l’emprise des hommes, elles ne s’abandonnent pas et se soustraient à leur jouissance en montrant autant de vie que les poupées de chiffons. Du coup, lorsque ces dernières sont secouées en tous sens, ce sont bien les femmes qui sont violentées. Ces femmes, filles encore et toujours, et épouses bientôt, laissent aux poupées la robe blanche et le voile, s’obstinent dans leurs robes aux teintes chaudes mais sombres, robes en corolle sous lesquelles on aperçoit des culottes blanches. Les hommes défient les femmes, les défont sans qu’elles se défilent. Elles travaillent non pas à accepter, mais à avoir la force de se détruire (et bientôt leur seul travail sera l’accouchement). A cet égard, les sauts dans lesquels elles se jettent depuis les bancs sont autant d’assauts.

Chacun court, prend appel sur le banc et s’élance dans le vide, rattrapée au vol par l’homme qui assis dos à elle sur le banc, la tête désespérément face au public, s’est levé au moment exact de son appel sur le banc, et sitôt réceptionnée, ils s’effondrent et roulent sur le sol. Cela se répète, en chœur ou en canon, jusqu’à ce qu’une seule femme s’élance alors que toutes les autres sont laissées à terre pour mortes. Ce qui pourrait être un geste de confiance absolue (et il en faut dans son partenaire, qui n’a aucune marge pour réceptionner celle qu’il ne voit pas mais sent uniquement au dernier moment, lorsqu’elle est à sa hauteur) en est un de désespoir plus grand encore, destruction de soi lancée contre l’autre, contre l’homme qui bientôt la fera rouler sur le lit comme il la fait rouler par terre, finalement clouée sous lui. C’est affreux et magnifique – déchirant.
La fin serait davantage poignante, dans un apaisement tout relatif : en ligne et de dos, les cinq couples avancent vers le fond de la scène, remontent l’allée vers le château ; ce pourrait être une apothéose, mais c’est au contraire une marche funèbre qui s’enfonce lentement dans l’obscurité des projecteurs noyés : les femmes guidées et aveuglées par la main des hommes se sont résignées – à n’être jamais résignées.
Noces sacrées
Le sacre du printemps n’est peut-être pas celui de Preljocaj, mais il n’empêche pas que cela soit réussi et en parfait dialogue avec la pièce précédente. Rarement programme aura été plus cohérent. En effet, on retrouve une tension semblable entre ce qui est voulu et ce qui est souhaité, à ceci près que la contrainte qui est en le ressort n’est plus sociale, comme c’est le cas dans les Noces, mais intérieure, propre à l’individu comme être désirant, partagé entre le sexe et l’effroi.
Les femmes passent le plus clair de leur temps à courir, comme traquées par un meurtrier, pour échapper aux mains qui les soumettront à leurs désirs : question de vie, vraiment, et de sexe. Le premier tableau, pourtant, n’est pas de chasse : une jeune femme traverse la scène, s’immobilise ; la main se crispe sur le tissu de la jupe courte, on voit que le geste est malaisé par le transfert du poids du corps d’une jambe à l’autre, il l’engage plus qu’elle ne le voudrait ; la main froisse le tissu, et les doigts en rassemblent peu à peu les plis vers le haut, jusqu’à ce que les doigts puissent se glisser dessus, en haut de la cuisse, et en retirer la même culotte blanche que les filles de noces tout à l’heure ; elle ne l’enlève pas, néanmoins, et la petite culotte lui reste sur les chevilles. La scène se répète avec chaque fille, en canon et bientôt toutes les petites culottes sont à leurs pieds, résistent à leurs ronds de jambes en l’air, entravent leur volonté de mouvement. Ce sont bien les femmes qui ont ouvert le bal, qui se sont ouvertes et comme offertes aux hommes qui viennent de quitter leurs poses plus ou moins faunesques en arrière-scène, sur des blocs de gazon, et reniflent les petites culottes qu’on leur a remises, plus prosaïques qu’un voile.
Cette initiative des femmes ne fait que rendre ensuite leur capture plus violente. Chacune sur leur piédestal de gazon (les blocs sont mobiles, s’emboîtent, se reconfigurent ou s’écartent pour créer un paysage vallonné ou ravagé), leurs poses sont lascives, mais prises en poursuite par les hommes, elles ne veulent pas, si bien que lorsque les hommes leur arrachent leur haut, et qu’elles sont clouées sur leur bloc de gazon (à la fois à terre et en l’air, s’il est vrai que les blogs surélevés pourraient à ce moment faire songer à des lits); les scènes d’accouplement sont d’une violence incroyable. Et d’une telle force érotique, en même temps, qu’on ne peut pas s’empêcher de trouver magnifiques toutes ces évocations de coït éparpillées côte à côte sur la scène.

Je crois que c’est pour moi le paroxysme de la pièce, la tension retombe quand les corps des femmes en soutien-gorge se traînent dans une lumière affaiblie, je décroche un peu. Je ne comprends pas vraiment la fin (et ne suis pas la seule), ou alors comme passage obligé de la relecture : le sacrifice d’une jeune femme fait basculer la tension de l’individu et du couple au groupe. L’Élue (qui rappelle un peu les « volontaires désignés » d’explications de texte pour lesquelles personne ne se dévouait) est jetée dans le puits des six blocs ré-assemblés par tout le groupe en furie, l’opposition féminin-masculin se perdant dans l’élection d’un bouc émissaire. Le groupe enragé lui arrache ses vêtements, jusqu’à ce qu’elle se retrouve entièrement nue, et qu’elle retourne contre eux son agressive beauté. D’une certaine manière, on ne peut plus rien contre elle, la nudité annule la vulnérabilité de la dénudation (why Newton’s nudes are that big, do you think ?). Peut-être est-ce là une forme de libération dont l’exultation (par l’artiste) n’est cependant pas débarrassée de colère (pour le personnage), mais c’est en tout cas la fin du désir, auquel à été substituée une autre tension, celle de l’individu et du groupe. Le solo de gesticulations n’apporte plus grand-chose et je ne peux trouver de justification à sa durée qu’en y voyant le moyen de désamorcer tout voyeurisme. Curieux aussi, d’une certaine façon, les applaudissements nourris pour cette éphémère soliste ; je suppose qu’on salue son audace, mais soupçonne nombre de spectateurs de croire que la nudité est garante de la vérité, qui se trouve pourtant bien en amont du sacrifice final.

Bien qu’ayant préféré les Noces, qu’aucune petite mort chorégraphique ne vient entamer, les deux ballets s’accordaient parfaitement pour une soirée tout en intensité. Il y a en effet ceci de formidable dans les ballets de Preljocaj (dans ses productions grand public, à tout le moins, que je préfère aux interrogations tortueuses du Funambule, par exemple), c’est que danseurs et danseuses redeviennent sur scène hommes et femmes. Le mouvement y est toujours un geste ; et c’était particulièrement vrai avec la danseuse asiatique dont la danse était toujours plus lisible que celle, pourtant identique dans les pas, des autres.