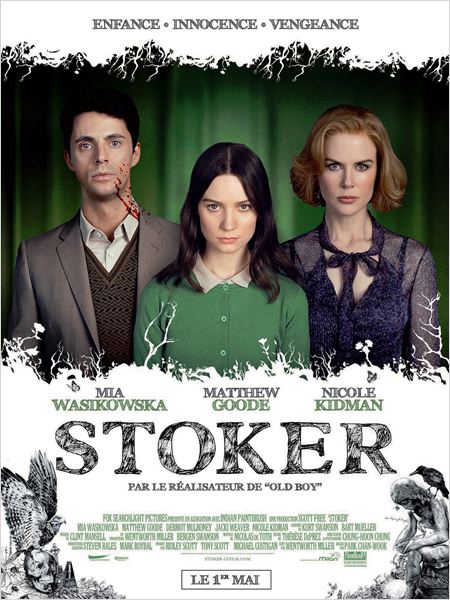Sofia Coppola partage avec Martin Parr une fascination pour la société des (riches) apparences dans ce qu’elle a de plus clinquant et… un positionnement artistique ambivalent, qui flirte avec l’imposture comme avec le génie : le redoublement des images assurant à lui seul toute portée critique, celle-ci risque toujours de laisser place à la complaisance.
Sans y toucher, The Bling Ring accumule les images, toutes sortes d’images : depuis celles qui se trouvent dans le film (les photos pour lesquelles les ados prennent la pose en soirée ou celles qu’ils trouvent dans la maison de Paris Hilton, laquelle raffole de sa propre image au point d’encadrer les magazines dont elle a fait la couverture et d’avoir des coussins à son effigie) jusqu’à celles qui animent le film dans une esthétique de clip, flash et ralentis à l’appui (chaussures, sacs et bijoux en sont les stars, bien plus encore que celles auxquelles ils appartiennent), en passant par les images qui appartiennent à l’histoire mais sont arrachées à leur contexte pour devenir matière filmique. C’est ainsi que le mur Facebook des protagonistes se déroule sur l’écran de projection et non plus sur celui de l’ordinateur, que les photos de star défilent sous forme d’un diaporama accéléré, comme les pages d’un magazine que l’on feuillette. Il en va de même pour l’image filmée : Sofia Coppola troque ça et là la caméra pour la webcam, devant laquelle les ados paradent, et la caméra de surveillance, verte au possible, qui tente tant bien que mal de réinvestir un peu d’objectivité sinon morale du moins juridique dans les déambulations nocturnes des ados.
Peut-être est-ce en acceptant des images brutes que Sofia Coppola parvient à montrer ce qui dérange le plus. Ce n’est finalement pas le vol qui est le plus choquant (après tout, il existe tout une tradition du vol héroïque, depuis celui, très moral, de Robin des bois à celui de l’escroc de haut vol que l’on admire pour son adresse, qu’il se nomme Arsène Lupin ou Ethan Hunt (Mission impossible)), c’est l’insouciance avec laquelle ils s’y prêtent : aucune autre préparation que le repérage de l’adresse et la vérification de l’absence de la star. Pas de lampe torche ni de matériel pour crocheter les portes, on cambriole en talons et à visage découvert, tranquillement, sans se presser, en cherchant la baie vitrée qui n’a pas été fermée. Ne serait-ce l’angoisse du garçon de la bande (qui, avec ses talons aiguilles rouges et son béguin pour l’initiatrice des cambriolages, est le plus normal de la bande), on la croirait en train de faire les boutiques – Sofia Coppola nous en offre une rapide séquence témoin. Difficile de trouver acte répréhensible moins transgressif qu’une virée annoncée par un « Let’s go shopping ! » enjoué.
Aucune animosité des gamins envers les stars qu’ils dévalisent : non seulement ils n’ont pas de revanche à prendre (vous et moi pourrions faire rentrer tout notre appartement dans leur salon – voire leur cuisine) mais ils sont mus par l’admiration. Piquer dans une garde-robe revient pour eux à approuver un goût sûr, un style marqué – et griffé : Dior, Chanel, Miu Miu et même Hervé Léger (épiphanie de l’élégance entre une veste en fausse fourrure et une robe léopard). Les garde-robe des stars sont telles qu’il est impossible que tous les vêtements soient à nouveau portés ; il semblerait presque sain de les délester d’une ou deux pièces si passer une robe ne faisait pas aussi passer les ados de l’autre côté du miroir, devenant l’image qu’ils admiraient. Seuls, ils n’ont plus qu’à recommencer ailleurs, encore et encore, tenter d’absorber la célébrité pour, au final, ne collectionner que des images. Si la bande se met à revendre des objets, c’est finalement plus par dépit que par amour du gain. Cet argent, dont ils n’ont pas besoin, est ce qui achève de les faire ressembler à leurs idoles, parti en fumées illicites et rasades d’alcool – le sexe est le grand absent de cette vie soi-disant rock’n’roll. Il y a bien une scène, où l’on ne voit rien, sinon un flingue pour compléter le tableau – rien qui risque de rendre la chair sulfureuse à ces images ambulantes.
Dans cette fable des temps modernes, la justice remplace la morale. Police, tribunal et prison se succèdent sans qu’aucune prise de conscience n’ait lieu, sûrement parce que ces voleurs d’image n’ont jamais cessé d’avoir conscience de la leur : c’est encore sous les caméras qu’ils se repentent (en accusant la société des images – quand on maîtrise le maniement du miroir, on peut lui faire réfléchir ce que l’on veut) ou clament leur candeur (le plus dur, en prison, c’était évidemment les uniformes oranges, affreux). Dans ce repentir exhibitionniste, le personnage d’Emma Watson est particulièrement savoureux, qui piétine joyeusement le souvenir d’Hermione en remarques de crécelle sans cervelle… Et l’on se dit que Paris Hilton a dû bien s’amuser, à jouer son propre rôle : se déguiser pour mieux se ressembler – et s’en dédouaner aux yeux du public, charmé par l’auto-dérision. La mise à distance présuppose l’intelligence et le spectateur, soupçonnant la complaisance et doutant que la mise en perspective ait encore un sens au milieu du vide, se voit néanmoins obligé d’accorder le bénéfice du doute. Sofia Coppola, quand tu nous tiens…
Mit Palpatine.