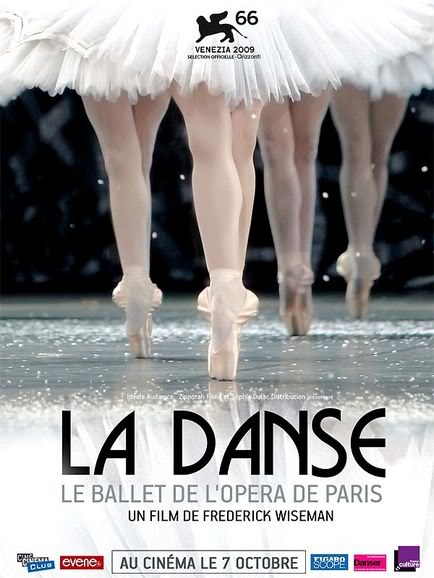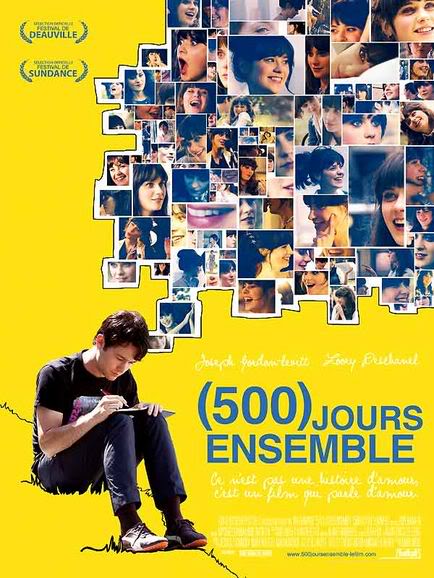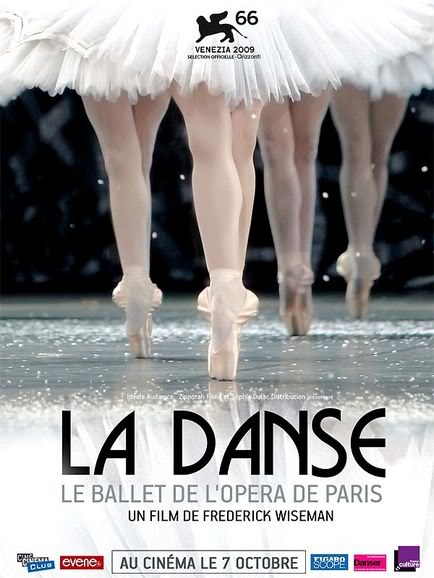
Le bas de l’affiche
Le gros plan sur les jambes des flocons de Casse-noisette, qui constitue l’affiche d’un nouveau documentaire au titre ô combien original de La Danse, n’était pas pour me rassurer sur le potentiel niaiseux du film. Ajoutez à cela une police peu sage– mais qui tire plus sur l’art déco que sur l’anglaise kitsch de la collection de DVD de danse, qui sort en kiosque (après, quand il s’agit d’avoir les Joyaux dans une distribution de rêve pour 12€, on passe rapidement sur le mauvais goût du maquettiste)- j’avais quelques craintes.
Peut-être aurais-je dû être davantage sensible à la composition, les tutus devenant graphiques en créant une zone blanche symétrique à celle où figure le titre. Peut-être cette affiche est-elle plus simplement destinée à faire venir les fétichistes des tutus-diadèmes-pointes, sans pour autant perdre le balletomane pur et dur qui viendra quand même, quelle que soit l’affiche, l’occasion étant trop rare pour être snobée. Mais…, bredouillez-vous, cela signifierait-il que l’amateur de tutus-diadèmes-pointes ne serait pas venu autrement ? J’en ai bien peur. Pour tous ceux qui n’appartiennent pas à cette catégorie, réjouissez-vous : ne vous fiez pas à l’affiche, c’est un attrape-nunuche.
Un anti-âge heureux
Dès les premières images, le ton est donné : passé un plan général du palais Garnier (on y échappe difficilement), on nous plonge dans les caves du lieu, avec ses couloirs gris et glauques, pleins de tuyaux et de repères tracés à coup de fin de pots de peinture, puis au niveau des machineries (ou de stockage de bobines et autres lourds accessoires non identifiés). Pas d’envolées lyriques sur les toits de l’opéra : tout au plus nous montrera-t-on, avec des images type documentaire animalier sur Arte, la récolte du miel qui y est cultivé. Pas le temps d’entrer dans les alvéoles, la ruche bourdonne en tous sens, de la musique sort de tous les studios, et celle qui s’attarde pour répéter quelques enchaînements de Médée se retrouve enveloppée de bribes de Casse-noisette.
Pourtant, la caméra ne croise personne dans les couloirs, glisse sur les escaliers ne grouillant pas d’élèves comme avant un défilé, et s’attarde sur les bancs vides qui meublaient les vestiaires des petits rats de l’Age heureux.
Les habitués de documentaire de danse souriront peut-être également devant la séquence un peu longue sur la cantine de l’opéra : il y a certes du brocolis, mais avec de la semoule et de la sauce, et sans pomme. Pas de fixette sur le menu diététique pour le rester (menue).
Vous l’aurez compris, le documentaire prend le contrepied de l’imaginaire de la ballerine, et c’est se montrer à la pointe que de repartir du bon pied. Pas d’overdose de pointes, pendant qu’il en est question : hormis Casse-noisette et Paquita, qui sont surtout là pour nous donner à voir le travail du corps de ballet, on fait dans le contemporain, en mettant l’accent sur l’élaboration de l’interprétation qu’il requiert pour les solistes.

L’anti-glamour est poussé jusque dans le classique pur : la sueur n’y est pas luisante. Le traditionnel travelling qui remonte en gros plan des pointes au plateau du tutu prend un tout autre sens lorsqu’il suit les jambes de Pujol (je ne suis plus bien sûre) en répétition : pointes destroy, collants blanc au-dessus de la cheville, sudette qui coupe le mollet et, cherry on top, le short-culotte rose sous le tutu blanc de répétition. C’est ce qui s’appelle en tenir une couche.

[Bon, on n’échappe pas au quart de seconde David Hamilton…]
La voie du sans voix
On peut trouver que le documentaire met du temps à démarrer, mais force est de capituler : on attendra en vain une voix off. La caméra filme comme un œil omniscient derrière lequel s’efface le caméraman muet (au contraire de Nils Tavernier qui posait des questions tous azimuts) et que l’on oublierait presque si le montage ne rappelait pas la subjectivité d’une présence. Pas d’enième compte du nombre de danseurs dans la maison, du parcours du quadrille jusqu’à l’étoile, des plaintes sur la fatigue physique compensées par des yeux brillants ouvrant sur des soupirs d’enthousiasme. Mais pas d’indication non plus : on ne sait pas qui danse, ni quoi, qui fait répéter, quel nom porte ce chorégraphe…

Les seules « explications » que l’on obtienne, c’est par le truchement de Brigitte Lefèvre. Mais là encore, il faut souligner qu’elle apparaît d’abord au téléphone et qu’elle ne s’adresse pas plus à la caméra par la suite. Elle est prise dans son rôle de directrice de la danse, qui se doit de recevoir les partenaires (l’organisation de la réception des mécènes américains lors de la venue du NYCB vaut son pesant de cacahuètes – « et que peut-on prévoir plus particulièrement pour les « bienfaiteurs » ? Ce sont les plus de 25 000 dollars. »), les chorégraphes (je ne sais pas qui c’était, mais il ne comprenait visiblement pas la différence de statut entre les étoiles et le corps de ballet) et les danseurs (crise de fou rire devant la piquante danseuse –who ?- qui vient refuser le pas de tr
ois de Paquita, parce qu’elle est déjà bien trop distribuée et que bon, elle n’a plus vingt-cinq ans).
Frederick Wiseman ne prend pas la parole, mais il ne la donne pas non plus : on évite les approximations de danseurs qui ne sont pas rompus à la parole et on les laisse s’exprimer de la manière qui leur convient le mieux : par le geste (dansant ou pas, selon qu’il s’inscrit dans la chorégraphie ou dans l’attitude lors d’une répétition). Alors que souvent dans les documentaires la caméra glisse d’une salle à l’autre et prend la fuite sitôt la variation finie, Frederick Wiseman prend le temps (et en 2h40, vous avez le temps d’avoir mal aux fesses – à ce propos, Palpatine, ton titre était déjà pris : « C’est long mais c’est beau. Rien n’est aussi délicat à filmer que la danse, et Wiseman le fait somptueusement. » Anne Bavelier, au Figaroscope) de filmer les tâtonnements et même l’épuisement (Marie-Agnès Gillot allongée/terrassée après un long duo).
En habituant les danseurs à sa présence discrète (Frederick Wiseman a tourné pendant douze semaines), et en ne les délogeant pas de leur mode d’expression qui leur est propre, la caméra évite la pose. Grâce à ce témoin peu indiscret, on a le droit à de savoureux dialogues. Le premier à avoir fait rire la salle est le désaccord sur la descente par la demi-pointe entre Ghislaine Thesmar et Lacotte (les noms grâce à Amélie).
Mais j’ai de loin préféré les commentaires lors de la répétition sur scène de Paquita. La caméra ne quitte pas la scène, mais, exactement comme si l’on était installé dans l’obscurité de la salle, on entend deux voix (dont une doit appartenir à Laurent Hilaire) qui commentent tout. Et c’est croustillant. On sent le maître de ballet généreux et énergique, mais dont l’enthousiasme, sous l’effet de la fatigue, commence à dégénérer en un état second joyeusement hystérique. Tout haut : « non, les garçons, non, les deux lignes, écartez-vous, vous voyez bien qu’il n’a pas la place de passer ! non, mais…. Pff. On recommence… (un temps)… il va bien falloir que ça la fasse, de toute façon. ». Un temps. Tout bas, dans un soupir : « putain… ». Puis viennent les commentaires réjouis sur Mathilde Froustey : « -Mais c’est quoi ce short rose ? – Elle est arrivée en retard. –Oh… » ; sur un garçon : « facile pour lui, c’est presque indécent » ; et deux filles : « Ah ! Celles-ci, c’est formidable, elles l’ont fait tellement de fois, qu’on les branche ensemble, et hop, ça marche ».
Variations pour un balletomaniaque
En l’absence d’indications, ce documentaire est un terrain de jeu rêvé pour le balletomane qui, interloqué un quart de seconde d’entendre « Ton pied, Létice ! », s’écrit aussitôt en son fort intérieur : « Laetitia Pujol ! » ; le degré de balletomaniaquerie étant inversement proportionnel au grade du corps de ballet. Aux nombreux points d’interrogation qui me restent, j’en déduis que je suis bien loin de la névrose. Après la devinette de l’identité grâce à la façon de danser, au visage et éventuellement au prénom prononcé par le répétiteur ou le chorégraphe, les tics de ces derniers constituent une nouvelle source d’amusement. La plupart du temps en anglais (avec ou non accent russe ou autre), les indications sont doublées de broderies musicales très variées « ta da dam, di da dam, pa da dam, ta da daaaaam » (les voyelles ainsi étirées signifient « bordel, sur le temps, l’accent ! en mesure les filles ! »), « la la na na na la laaaa na la na naaa » « bim bim bim didididim » et plus contemporain « chtiiiiiii yaak, chti papapapapam, chti chtouu dou chti tchi tchiii ya ».
Les choix des solistes filmés seront toujours discutés. Pour ma part, ça donnerait quelque chose comme ça : Marie-Agnès Gillot crève l’écran, thanks a lot ; clairement pas assez de Leriche et Dupont, c’est une honte ; plus de Pech, de Romoli et de Dorothée Gilbert n’aurait pas nuit ; trop de Cozette, et légèrement trop de Pujol (pas intrinsèquement, plutôt par rapport à ceux qu’il n’y a pas) ; j’aurais bien aimé voir Myriam Ould-Braham en répétition ; où sont donc passés Karl Paquette, Delphine Moussin et Eleonora Abbagnatto ?

Côté chorégraphes, il va falloir que je découvre Sasha Waltz (si c’est bien sa version de Roméo et Juliette que danse Dupont sur la scène inclinée), et les extraits de Genus (si ce sont bien les justaucorps bleus avec des espèces de colonnes vertébrales blanches dessus) m’ont donné une furieuse envie d’aller voir du Wayne McGregor (au programme cette année).

Hors des coulisses, le travail
Le frisson du hors-scène n’est pas le seul ni même le principal ressort de ce documentaire : les coulisses sont bien moins le champ d’investigation de Frederick Wiseman que le studio, et si l’on y parle beaucoup, ce film demeure étrangement muet. Quoique… muet comme une danse, parlant à sa manière, par ses angles de plan, son montage, son mutisme même. Il parvient à renverser la tendance du spectateur à envisager le « hors-scène » d’après le spectacle auquel il assiste, vers la perspective du danseur dont le quotidien culmine dans la représentation (sommet, mais finalement assez ponctuel dans le cheminement journalier). Il montre que le travail de la danse n’est pas seulement un résultat (au sens où un élève rendrait ses travaux pour que son professeur les corrige), mais d’abord un entraînement de longue haleine (on dit bien que le bois d’une charpente travaille) et aussi un emploi (Garnier pour bureau).
Frederick Wiseman : « Tous les gestes des danseurs sont du travail, de l’entraînement dès l’âge de 6 ou 7 ans, pour manipuler le corps et arriver à ces choses si belles. Et puis, lorsqu’ils sont plus âgés, ils ont souvent des maladies très liées à leur carrière. Dans un certain sens, c’est une lutte contre la mort, parce que c’est quelque chose de très artificiel. Et on sait que ça ne dure pas, parce que le spectacle est transitoire, mais également le corps. Et c’est un privilège de regarder les gens qui se sont consacrés à cette vie, et ne peuvent pas gagner cette bataille contre l’usure et la mort, ou alors pour très peu de temps. Cela m’intéresse beaucoup : la danse est si évanescente… »
Le travail comme emploi

Les séquences sur les petites mains qui brodent les costumes, la directrice de la danse qui gère l’administratif en relation avec les danseurs, ou encore les hommes de ménage qui passent dans les loges avec un aspirateur sur le dos ne sont donc pas inutiles en ce qu’elle
s permettent de replacer les danseurs dans un contexte qui n’est pas seulement artistique. Il ne s’agit pas de démystifier quoi que ce soit, mais de réinscrire les danseurs dans « la grande maison » (au sens très littéral : on voit des ouvriers replâtrer les fissures ou passer un coup de peinture sur les murs) et, plus largement encore, dans la société actuelle : ils sont salariés, et la question des retraites se posent pour aux aussi –d’autant plus qu’ils partent à 43 ans- ; j’ai été bêtement surprise lorsque Angelin Perljocaj explique que la main de Médée, qui passe sur le cou du Jason est à mi-chemin entre la caresse et la coupure, « vous savez, comme ces personnages dans Matrix qui ont des trucs au bout des mains… ils voudraient aimer mais ne peuvent pas ». Et Romoli de renchérir « Edward aux mains d’argent, quoi. » Ils continuent d’exister hors scène et hors opéra, mais rien à faire, le hors-contexte fait toujours un drôle d’effet.
Le film montre la danse comme un emploi, l’Opéra comme une administration. Dès lors, que les prises extérieures de Garnier et Bastille ne soient pas esthétisées, mais pleines de bruit, de pluie et de circulation, les intègre d’autant plus au parti pris du documentaire qui ne trace qu’une ligne des feux de la rampe à ceux de la circulation. Ne circulez pas, y’a à voir !
Le travail comme modelage du matériau qu’est le corps
Une respiration essoufflée vaut mieux qu’un long discours, et le temps de filmer une répétition, celui de faire parler les intéressés. C’est la première fois qu’un documentaire me donne à sentir ce que pouvait entendre Aurélie Dupont lorsqu’elle disait qu’une étoile était très seule. Ce qu’on voit habituellement des répétitions (temps d’une variation, ou répétition plus longue, mais parmi les dernières, c’est-à-dire quand les étoiles sont réunies avec le corps de ballet) ne laissait pas imaginer le triangle maître de ballet-étoile-miroir, avec le premier qui finit par laisser le silence se refermer sur le face-à-face des deux derniers. La danseuse se retrouve happée par son image, ainsi que le suggère le plan sur la jonction de deux miroirs où le corps tronqué du danseur vient à disparaître après s’être abi/ymé. La personnalité des maîtres de ballet prend d’autant plus d’importance ; autant Clotilde Vayer semble de glace, autant Laurent Hilaire paraît à même de fendiller cette espèce de solitude.
A ce niveau, mis à part quelques corrections techniques, les indications ne sont plus que des conseils et, une fois, dispensés à l’étoile, celle-ci est seule en scène. C’est d’ailleurs là qu’on a confirmation de ce qu’Emilie Cozette est plus une bonne élève qu’une brillante étoile : il faut que Laurent Hilaire lui décrypte chaque geste de la chorégraphie de Médée, qu’elle peine visiblement à s’approprier…
Sur fonds de cette solitude, la fatigue des corps couverts de pelures diverses et avariées ressort bien plus que par un plan ciblant une douleur particulière. Le grand classique du pied plein d’ampoules fait grimacer, mais n’a rien de commun avec la fatigue générale d’un corps fourbu d’être tant sollicité.

Le travail comme résultat
Chronologie, même lâche, oblige, on va plus ou moins de la répétition au spectacle abouti, sur scène. Mais le documentaire est tel que plutôt que de garder en mémoire le travail qu’il y a « derrière », on continue à voir dans la représentation le travail toujours inachevé du corps qui cherche continuellement le mouvement. Wiseman a compris que le spectacle ne se laisse pas filmer comme tel, qu’il y a besoin de tourner autour et de zoomer tout comme l’œil suit tel ou tel détail au gré de ses caprices (condition sine qua non pour ne pas mourir d’ennui au bout de cinq minutes – même si l’on a parfois le désagrément de constater que l’on n’a pas du tout la sensibilité du cinéaste, et que l’on aimerait toujours que la caméra soit dans le champ de ce qu’elle exclut), d’où que ses échappées hors scène vers les tringles en pleine chorégraphie ne sont pas du tout gênantes. Il en résulte que le mouvement est pleinement rendu. Et l’on se dit qu’au final, un titre banal mais dépouillé n’est pas si mal choisi pour ce film brut – ce n’est pas une pépite, pas d’ « étoile » dans le titre- qui se place continuellement en retrait pour aller au fonds des choses. Apre ou pudique, presque rien.