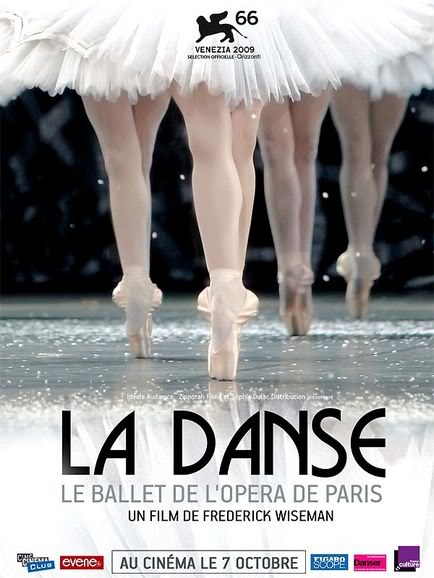Certaines œuvres comiques m’incitent parfois à croire le temps de leur représentation que les œuvres dites sérieuses n’ont été inventées que pour offrir le plaisir de les parodier ensuite. Ce sont celles dont la bouffonnerie ne tombe pas dans le grotesque et dont l’humour ne tombe jamais à plat, c’est Platée, en l’occurrence, servi par une mise en scène délirante : Laurent Pelly ne recule devant rien, sauf devant l’excès du mauvais goût. L’opéra joue avec les conventions du genre, mais nul besoin d’être un fin connaisseur pour apprécier l’ironie. Quelques mots du contexte musical permettent certes de souligner l’originalité de cette œuvre qui annonce ou parodie les opéras italiens en mélangeant les genres pourtant bien rangés dans leurs cases par les Français. Cependant, si cette mise en perspective historique présente Platée comme un brillant pastiche, l’opéra, comme toute œuvre digne de ce nom, va bien au-delà de la caricature et peut être apprécié pour lui-même, sans avoir forcément besoin d’être référé à ce qu’il pastiche.
–Quoi, moi ? – Oui, toi !
Le rideau se lève sur… une salle de spectacle, dont les gradins sont peu à peu remplis par des spectateurs retardataires (on notera le souci de vraisemblance), que placent, déplacent et replacent une escouade d’ouvreuses hyperactives et bientôt épuisées de gambader dans leurs petits uniformes d’hôtesses de l’air. Le calme ne se fait pas dans les rangs, loin de là, c’est même la débandade : on descend les escaliers sur les fesses comme des enfants boudeurs ou l’on avance entre les sièges à quatre pattes (l’étroitesse des rangées ne le permettrait pas, dommage, l’idée était bonne), l’ouvreuse-meneuse de revue la lampe torche dans la gueule, comme une rose à la bouche d’un séducteur de pacotille.
Au premier rang, affalé sur plusieurs sièges, Thespis cuve son vin. La troupe de spectateurs vient le réveiller en chœur et réclame une histoire pour célébrer Bacchus. L’inventeur de la comédie finit par accéder à la requête des spectateurs, qui ne sont autres que la transposition de vendangeurs – serions-nous rustres ? à en juger par l’imbécile heureux à qui j’ai du arracher son enveloppe pour qu’il cesse d’en faire bruire l’ouverture en papier cristal, l’insinuation n’est pas dénuée de fond ; se trouver dans l’enclos optima avec ses nobles moutons cravatés et emperlousés n’y change rien (premier rang de premier balcon, ces places –Palpatine fait le pluriel- de dernière minute étaient un véritable cadeau de Noël, le guichetier en a convenu). Il faut dire aussi que Thespis, mal embouché d’être éveillé après tant de bouteilles débouchées a prévenu que tout le monde en prendrait pour son grade – Dieux comme mortels. Personnages comme spectateurs, pourrait-on ajouter, s’il est vrai que l’adage de corriger les hommes par le rire prend un certain relief avec le mont Cithéron transformé une salle de théâtre. On a moins une mise en abyme (même si à un moment, une miniature de scène tombe du ciel, enfin des tringles, pour encadrer les spectateurs regroupés en chœur) qu’une inversion des perspectives : ceux que nous observons à leur tour nous observent et nous renvoient ainsi notre regard.
L’impression est assez curieuse, quoique moins forte qu’à la séance de cinéma où quelques personnes arrivées en retard, au lieu de se faire discrètes, ont pris le parti de jouer leur rôle d’emmerdeurs, et ont fait savoir sur le ton de l’aparté mais à toute la salle qu’ils étaient en quête d’une place. Le rire s’est propagé dans les gradins, avec une bonne humeur suffisante pour que la bouffonnerie soit poussée jusqu’à leur faire une haie de déshonneur et qu’elles accèdent aux places centrales vacantes. Si le dérangement, quoique abusif, n’a pas été perçu avec animosité, c’est peut-être aussi qu’il constituait un dérangement des habitudes. Ainsi, le rire des spectateurs installés visait moins à se moquer des retardataires qu’à prévenir toute gêne –celle de se sentir observé alors que les salles obscures sont par excellence le lieu où l’on voit sans être vus (les couples d’amoureux affalés l’un sur l’autre sans aucune retenue sont un bon indice de la prégnance de ce sentiment d’être dissimulé). L’irruption des retardataires qui se sont adressés aux spectateurs au lieu de faire rapidement et tacitement corps avec eux a transformé les gradins du cinéma en amphi qui rit d’être pris sur le fait (rien de répréhensible – les spectateurs pris à parti sont comme des écoliers soudainement interrogés par un professeur qui, ce faisant, les distingue du groupe dans lequel ils se fondaient, invisibles). Cette impression est moins forte sur scène où, contrairement à l’image des acteurs qui ne risquent pas de nous répondre, de véritables personnes évoluent sous nos yeux. Il n’en reste pas moins que le renversement des perspectives produit un drôle d’effet en enfreignant la convention habituelle selon laquelle les comédiens ou chanteurs se laissent regarder en faisant semblant de ne pas sentir les regards posés sur eux. La scène constituée en salle fonctionne donc comme un miroir, et c’est donc bien le spectateur que le spectacle représente – et moque, en l’occurrence. Le spectateur, spectateur de lui-même grâce au spectacle dont il se croit le témoin et non l’objet : *Proust power*.

Quoi, l’on se rit de nous ? Et l’on fait bien – de ne pas prendre au sérieux le sérieux des hommes *Kundera power* – de rire même de cette tentative trop sérieuse de le démontrer. La mise en scène le montre assez bien à elle seule : de la mousse verte envahit peu à peu les sièges et transforme la salle en épave, qui elle-même va partir en morceaux –de choix- tout au long de l’opéra. Le naufrage emporte avec le décor l’ambition d’éduquer les hommes par le rire – ne surnage que le divertissement. Le plaisir de l’histoire : Thalie, déesse de la comédie (Melendili, you were perfect), Momus, dieu de la satire (je ne le connaissais pas celui-là), et Amour, impertinente dans ses sous-vêtements encadrés d’une veste noire, veillent au grain (de folie). Et Thespis s’est assuré l’inspiration à l’aide de quelques ingurgitations : il a fait venir une longue table recouverte de verres de vin, d’où a surgi une grenouille (sic). L’élément perturbateur est annoncé.
Le croassement de l’histoire
Jupiter éternel séducteur, Junon, perpétuelle jalouse, Amour, joueur de fléchette… l’histoire est bien connue et le mythe, bien rôdé. Seulement, l’argument, c’est tout une histoire : les cases sont respectées, mais le livret d’Adrien-Joseph Le Valois d’Orville (le dernier ferme la porte) d’après une pièce de Jacques Autreau les remplit avec la légèreté d’un questionnaire de Cosmo quand il aurait fallu l’attention d’une déclaration d’impôts. La distribution se révèle cocasse : dans le rôle de la belle qui ravit le dieu des dieux, Platée, une « nymphe batracienne », être aussi fleur bleue que verdâtre, affublé d’un tutu de pétales roses.

Paul Agnew « mi-clochard, mi-reine d’Angleterre »
(on n’aurait su dire mieux, le petit sac vert est too much)
Forcément, dans ces conditions, l’histoire bégaie, le tragique tourne au comique – et la salle s’esclaffe de la plaisanterie montée par Cithéron et Jupiter, avec Platée pour objet et Junon pour destinataire, qui consiste à faire croire à celle-ci que Jupiter s’est épris de celle-là. La méprise n’aura d’égale que le mépris du dieu pour sa nouvelle conquête.
Platée ne court pas dans la combine, elle y saute à pieds joints, de son saut de batracien. C’est ce qui la rend ridicule, bien plus que appâts véreux – à chaque fois qu’il en était question, je ne pouvais pas m’empêcher de visualiser un vers visqueux se tortillant au bout d’un hameçon. Devient risible toute tentation de prendre quoi ou qui que ce soit au sérieux : Platée persuadée de sa beauté, l’amour et ses foudres, un des thèmes de prédilection de l’opéra et ses grands airs. Tout part en déliquescence, tout prête à rire. La destruction progressive du décor l’a pourtant planté : on nous laisse nous enliser à notre aise dans l’histoire, dans les marais de Platée.
Dans cette noble et putride demeure, il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille. Tous ses amis sont réunis pour l’occasion, une piscine leur est même aménagée par le retrait de quelques rangées de fauteuils et dans l’euphorie, les assonances en « oi » pullulent. Le jeu du cri des animaux continue avec les métamorphoses de Jupiter tandis qu’il se manifeste pour la première fois à Platée. La chouette l’est déjà pas mal (chouette), mais l’âne est impayable ; je ris tellement que je ne dois plus être très loin des grands hochements de tête de Jupiter dont la nature asine est déjà inscrite dans la partition. Croassements, ululements et braiements doivent avoir une sonorité particulièrement marquante ; ce sont précisément leurs onomatopées qui ont servi d’indices pour reconstituer la prononciation du latin (ne pas sous-estimer le potentiel comique d’un poly). De curieuses choses me passent par la tête en spectacle, je vous l’accorde, mais cela aurait pu être pire, j’aurais pu me revoir dans le Songe d’une nuit d’été en train de me pâmer devant l’âne.
L’apparition de Jupiter est ainsi céleste. Il est vraiment dans les airs, puisque descendu dans le lustre de la salle initiale. A bord de cette nacelle de récupération, il a l’air d’une caricature de pin-up dans une coupe de champagne. D’autant qu’il le vaut bien : le monsieur Loyal de tout ce cirque, en costume violet à paillettes (Mercure n’est pas mal non plus, très cloclo, tout argenté) a le sourire Colgate et la coiffure de Ken (hilarant jeu de scène lorsqu’il s’efforce de cajoler Platée : il caresse ses cheveux comme il le ferait d’un chien, puis après que celle-ci ait répliqué, il s’empresse de rectifier sa coiffure et de la débarrasser de la saleté éventuelle que la sale bête aurait pu lui laisser. Il se passe toujours quelque chose sur scène, toujours un détail croustillant à dénicher). Avec le lustre- nacelle de montgolfière, on a un nouveau clin d’œil aux artifices du théâtre, qui tout en s’en moquant, renoue avec la tradition des grands effets de machinerie. Jupiter est décidé à nous en mettre plein la vue, et bougie pétillante sur le gâteau, il fait même jaillir le feu de ses mains avant qu’une pluie d’étincelles s’abatte sur scène (c’est l’instant de la photo que l’on retrouve comme affiche et programme) – que voulez-vous, les feux de l’amour sont démonstratifs.

Aimer à la Folie
L’objet d’amour tient de l’affreux bibelot et Platée est tout juste un sujet : elle aime sur autorité du livret, avant même d’avoir aperçu Jupiter. Ce dernier est là pour nous rassurer, l’amour n’est pas aveugle, et souligner l’absurdité d’aimer à la folie. Toute marguerite vous confirmera la proximité de « pas du tout » avec la Folie. Si cette dernière surgit au mariage du couple improbable, ce n’est pas pour chanter les délices de l’amour, mais les délires d’une blague farfelue, après avoir piqué sa lyre à Apollon. Un peu de brutalité dans ce monde de douceur. Incarnation de la diva, Mireille Delunsch est magnifiquement excessive avec sa perruque blanche et sa robe en feuillets de partition. Elle mène tout le monde à la baguette, y compris le chef d’orchestre. Tandis que ce dernier, s’essayant à la comédie, s’arrache les cheveux pour la faire chanter en mesure avec l’orchestre, elle, arrache une des feuilles de son costume et consulte ainsi son antisèche.

Campée sur une petite avancée qui donne sur la fosse, vague souvenir d’un podium de défilé, ses grands airs et ses petites mimiques sont délicieuses. Plusieurs fois, elle revient sur son promontoire, prête à plonger dans la musique, mais c’est la grenouille du banquet initial qui plongera au sens propre. Apparue au balcon de la première baignoire côté jardin, elle lance une corde, descend dans l’orchestre et sans interrompre le bon cours de la musique, sème la zizanie, ébouriffe les cheveux d’un violoniste, change la partition d’un autre, zig-zag, fait de l’ombre au chef d’orchestre et finit par le saluer son travail en lui rendant sa baguette.
Voilà, j’ai trouvé ce que je voudrais faire quand je serai petite : grenouille dans Platée. La sœur du Vates voulait bien devenir flocon de neige dans la parade de Disneyland – nous avons de l’ambition. Je suis prédestinée, mon père m’appelait « la grenouille » quand j’étais bébé et que je dormais les pattes en losange. Puis cette grenouille qui efface les frontières bien définies de la représentation (qui paraissent toujours plus aisées à transgresser quand on est de l’autre côté de la rampe, d’ailleurs, où les coulisses ne constituent pas l’envers du décor mais une zone trouble où s’amorcent les métamorphoses), transforme d’un coup de baguette magique le chef en apprenti comédien, et fait de la fosse aux lions tout un cirque m’est très sympathique.
Un ballet-bouffon
Les rires ont besoin de danse pour devenir véritable fête : les ouvreuses hyperactives ont fait leur barre pendant le prologue, tandis que c’était le bar que leurs collègues masculins tenaient plus ou moins – dans l’esprit des serveurs de Roland Petit dans la Chauve-Souris. La bonne blague, la danse des canards grenouilles a fait régresser Mimy au stade de Mimicracra, l’eau elle aime ça, tant pis si ça mouille, elle fait des patouilles. Avec les trombes d’eau de la tempête souffle un vent à décoiffer les feuilles mortes (mais les perruques à l’horizontale tiennent bon), qui piétinent sur un rythme jubilatoire avant de se laisser emporter dans leurs robes déjà asymétriques sous l’effet de rafales anticipées par un costumier inspiré – elles reviendront ensuite équipées de tutus-parapluie. Les intermèdes de ballet suivants ont été un régal, pas la cerise sur le gâteau, non, le gâteau de mariage lui-même, crémeux à souhait. La ronde de danseurs qui accompagne la Folie, tous fardés de blanc, se lance dans une relecture du baroque où pointe l’hilarante bouffonnerie des ballets du Trocadéro : on s’endort dans les symétries, on s’entrechoque dans les lignes d’arrivée, et on attend sagement à sa place les bras bas et le dos rond. Suggérer la possibilité de l’ennui dans les divertissements brillants et systématiques du mariage est une façon pleine d’humour de souligner le caractère conventionnel de ce passage quasi-obligé dans une histoire, prétexte parfait à caser un patchwork de numéros décousus. Et si ce n’est pas un mariage, ce sera quelque autre grande fête, pratique et commode comme un beignet qu’on peut fourrer à tout et n’importe quoi (cf. Casse-Noisette, et son melting-pot de danse arabe, chinoise, espagnole… il y en a pour tous les goûts). La noce traîne en longueur pour Platée, impatiente sous son voile, et tend un peu trop dangereusement vers la prononciation des vœux pour Jupiter. Mais tout n’est que paix et amour. A moins que ce ne soit stratégie de séduction et désir de victoire écrasante : quoique vêtus de vert comme des herbes follement sauvages, le batifolage champêtre des danseurs est de courte durée. Bientôt, on s’excite les uns contre les autres, et l’un des messieurs se prend une volée de coups de sac à mains avant que le cortège ne défile en bon ordre pour les tendre (les mains) à Jupiter, félicitations. Cette partie me ferait davantage penser à l’enjouement d’un Mathew Bourne dans les scènes de société de son Swan Lake. Le metteur en scène et la chorégraphe, Laura Scozzi s’en donnent à cœur joie dans le dernier acte, leurs trouvailles trahissent une imagination délirante totalement débridée : les trois grâces sont des hommes maigrelets qui s’emmêlent le bras dans leur pas de trois et Cupidon, ayant été porté aux abonnés absents a dépêché un remplaçant qui n’a même pas eu le temps de finir de s’habiller et débarque en marcel, slip blancs et chaussettes noires – glamour attitude. Une platée de nouilles.

Tandis qu’on s’amuse, Platée s’impatiente, réclame l’amour et l’hymen ou « au moins l’un des deux » et Jupiter s’inquiète d’avoir à offrir quoi que ce soit. Heureusement, Junon surgit à temps. Violette de rage, prête à pousser sa rivale du canon de son fusil, elle ne fait que pousser un cri d’épouvante et de soulagement en découvrant le visage de cette dernière. La voilà bien attrapée : jamais plus elle ne pourra devenir verte de jalousie, sous peine d’être assimilée à la nymphe ridiculisée. Mais elle ne l’est déjà plus, non par l’effet de sa mansuétude divine, mais simplement parce qu’elle est rassurée – sa jalousie pourrait bien n’être que le résultat éclatant d’un complexe d’infériorité. Tout est bien qui finit bien. Platée ? Humiliée, rouée de coups de pieds… l’argument n’est pas une mince affaire, Platée a une certaine stature, il faut bien la fouler aux pieds pour conclure sur un pied de nez aux livrets trop bien léchés. C’est bête et méchant ? N’ayez crainte, comme Blanqui, la grenouille est increvable et s’accommodera très bien des yeux mouillés de Platée – celle-ci passe à la trappe, une dernière gerbe d’eau avant le noir final – retour à son élément.
Le sérieux de l’opéra dans tout cela ? Soyons sérieux une minute, il faut rire.