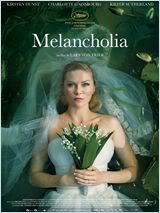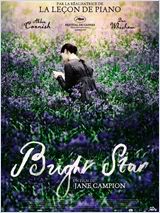Ce roman sur la vie de Doris Humphrey, je l’ai acheté il y quelques années déjà. Je l’avais commencé au stage de Cabourg, je me souviens, après les cours, dehors, sur la pelouse plus très verte mais je devais l’être encore trop, verte, pour l’apprécier vraiment et ma lecture s’est effilochée avant longtemps. Je suis contente aujourd’hui de l’avoir oublié sur l’étagère du bas, ma pile à lire horizontale, puis de m’en être souvenue cet été, avec un peu plus de maturité. Car l’essentiel de ce roman n’est pas la biographie qu’il contient (ou même les biographies puisque l’on croise Ruth Saint Denis, Martha Graham, Charles Weidman et José Limon… tout un pan de la modern dance) mais celle qu’il met en œuvre, à laquelle il redonne son mouvement, si juste pour une danseuse chorégraphe. L’auteur est l’une et l’autre, ce ne pouvait être autrement, il faut être monté sur scène pour faire ainsi corps avec l’écriture. On oublie les mots comme on oublie les pas pour ne lire que la danse. C’est déjà assez rare pour être signalé, ni biographie d’écrivain ni roman de danseur. Mais il y a plus – ou juste assez : les relations entre le trio de créateurs au sein duquel vit Doris Humphrey, et avec sa mère trop longtemps maman ; les échos déformés entre la vie et l’œuvre, les réinterprétations de coïncidences, (psych)analyses a posteriori mais jamais psychologisantes ; les influences d’une école à l’autre, la transmission entre continuité et rupture ; la vie du corps dans la durée et la vieillesse ; le compromis contre le renoncement… la chute et le ressaisissement, qui sont toute la danse d’Humphrey.
Pour toute la finesse de sentiment, il faut le lire ; inutile d’essayer d’en faire un condensé. Il y a néanmoins un aspect qui m’a particulièrement frappée par la franchise qu’il y a à l’aborder et par la justesse avec laquelle il l’est : le rapport entre danse et sexualité. Il me semble qu’on y comprend pourquoi cet art sensuel par essence, souvent vecteur d’érotisme pour le spectateur, n’est pas envisagé par le danseur en regard avec la sexualité, voire en est totalement coupé ; pourquoi, en somme, il y a un corps qui danse et un corps qui désire, distincts même si celui-là gagne à être confronté à celui-ci.
Maîtrise de l’emprise…
« Doris reste souvent choquée par les mœurs faciles de certaines condisciples. Pauline tente de l’assouplir :
Ne te défends pas, Doris, on danse aussi avec ça…
Ça ? Pauline semble déjà connaître. Doris préfère engouffrer l’essentiel de sa sensualité dans la danse. Sur scène, a-t-elle l’impression, rien ne la menace, et surtout pas la possessivité maternelle. Le rideau s’ouvre. Des hommes la regardent, apparemment offerte, mais c’est elle qui va les posséder. Elle sent les regards s’ériger vers elle dans l’ombre de la salle. Elle les tient à distance et défie le public, ce monstre ocellé d’yeux qu’elle aime apprivoiser puis subjuguer. Oui, faire vivre son immobilité compacte, lui imposer sa propre respiration ! Parfois il n’est plus qu’un troupeau de moutons aux têtes dodelinantes. Elle le provoque par un équilibre audacieux, le pénètre d’une enjambée, l’enveloppe de ses tours moelleux, le capture jusqu’à ce qu’il se délivre dans les spasmes des applaudissements. Elle salue et refoule une vague tristesse de n’avoir pu lui communiquer d’autres mouvements que ces frappes bêtement répétitives des mains. » (p. 30 – la pagination renvoie à l’édition poche d’Actes Sud, « Babel »)
« – Il te faudrait un homme, à présent.
Somnolente, Doris sursaute :
– Un homme ? Pour quoi faire ? Je suis très bien ainsi ?
– Pour danser mieux, ou du moins autrement…
– Quelle idée bizarre ! Si je parviens à m’améliorer, ce sera par un travail acharné.
[…] Elle n’a pas bien compris si son amie a voulu parler d’un partenaire pour la scène ou pour l’amour. Ou pour les deux ? Ça, jamais ! elle se refuse à pareil mélange, ses muscles et ses pensées tressautent de fatigue, elle s’angoisse : Pauline aurait-elle voulu suggérer que Doris atteindrait maintenant un plafond en tant qu’interprète ? » (p. 31)
« Les eaux mêlées de la danse et de la musique les unissent d’une coulée tellement plus intime que toute caresse. » (p. 43)
« […] elle savoure le plaisir du mouvement avec ce partenaire attentif. Leurs corps, lui semble-t-il parfois, se pénètrent à distance grâce à la sensualité partagée des rythmes et des respirations. Ils se rapprochent, basculent l’un vers l’autre, se nouent et se détachent avec délicatesse, se cherchent et s’accordent à nouveau dans une pulsation unique. Doris perçoit dans son dos, sans que Charles l’effleure, la caresse du tour qu’il achève et à la fin duquel elle s’appuiera sur lui, confiante, pour aspirer son énergie et rebondir. Charles pressent et soutient chez Doris la montée de l’excitation qui va l’amener au sommet d’un saut. Il l’aide à en amortir la retombée et ils repartent ensemble, étirant les mêmes lignes, déroulant la spirale qui les aspire l’un en l’autre. Soudain ils se séparent, parcourent l’espace, comme perdus, à longues enjambées, et se retrouvent face à face, éperdus, dans la proximité charnelle des souffles.
Doris se doute qu’elle ne peut se permettre avec lui cet érotisme sur la scène inépuisable de la danse que parce que l’espace étroit d’un lit leur est interdit. » (p. 53-54)
« […] Julia est sensible à leurs minceurs vibrantes, si bien accordées. Trop bien ? Saisie d’un doute, elle essaie de sonder Pauline avec une maladresse qui se prétend discrète dans l’insistance. La verdeur de la réponse scandalise Julia sans la rassurer :
Vous savez, ils font peut-être davantage l’amour en dansant que s’ils le faisaient pour de bon… »
« Doris éclate de rire : elle a tellement bien établi un clivage entre une sensualité inséparable pour elle de la danse et une sexualité repoussée à l’arrière-plan qu’elle ne peut imaginer que l’on subodore une liaison entre elle et son partenaire. » (p. 63)
La danse, parfois : « une fougue ou un moelleux dans le mouvement qui ne doivent rien à l’affectivité humaine, cette mélasse indigeste » (p. 71)
« Elle s’efforce de ne plus penser à une scène récente. Une plage isolée, la tiédeur du sable, la tiédeur plus douce encore de la peau de Wesley, les odeurs denses d’une végétation gorgée de sensualité. Doris s’était sentie sur le point de s’abandonner au rythme imposé par un autre corps. Pourtant, derrière le visage tendu de Wesley, elle contemplait la dérive dansante des nuages ? Au-delà de ce souffle masculin, trop haletant,, elle écoutait la rumeur souple et maternelle des vagues. Elle aurait souhaité les rejoindre. Elle pressentait trop bien la précision répétitive des gestes à venir alors qu’elle aurait voulu se fondre dans cette houle proche. Si l’amour avait pu devenir cette danse marine, celle que la musique ou l’océan déroulent dans une respiration inépuisable… Doris s’était dérobée. » (p. 73)
Comment un corps maîtrisé peut-il s’abandonner ?
« Lors d’une visite au temple de Konarak, elle est bouleversée par la crudité des sculptures érotiques. Émerveillée et révulsée en même temps, elle découvre que rien n’empêche l’alliance de l’art, du sacré et de cette danse de la sexualité qui anime ces pierres depuis des siècles : sexes dressés, mains fouineuses, bouches avides. Non, rien ne l’interdit, sauf elle-même en son for intérieur, sauf sa peur. Mais quel rapport entre les attouchements grotesques du Tchèque tripoteur de Chicago et ces hauts reliefs à la fois cosmiques et impudiques ? Les mêmes gestes, pourtant. Les mêmes, également, ceux tentés par Wesley. Aurait-il su l’entraîner dans une bacchanale similaire ? Qu’a-t-elle fui, manqué ? » (p. 78-79)
« Elle est maintenant la femme d’un homme, un bouleversement d’une lumineuse évidence. Son corps es
t fait pour l’amour et non plus seulement pour la scène. Un corps qui trouve à présent son ancrage dans les pulsations du sexe et parvient à éprouver au rythme d’un autre le même éclatement dissolu que dans le mouvement. Ce qu’elle avait voulu maintenir séparé s’est enfin relié. De la révélation de cet accord Doris ne dit rien à Pauline, pas plus qu’elle ne lui parlait autrefois de ses réticences secrètes. » (p. 186)
Un corps d’autant plus maîtrisé qu’il sait se ressaisir dans l’abandon…
Solo Deux Thèmes extatiques : « Avec son corps de danse, si bien maîtrisé, elle met en scène ce corps de chair qui lui échappe pour l’essentiel : l’instant dionysiaque où le danger de destruction rejoint la plénitude de la fête. » (p. 192)
… la maîtrise et l’abandon, miroir de la chute et du ressaisissement. Et l’on peut continuer à aimer et à danser, encore, en corps.
J’espère n’avoir pas rendu mon choix réducteur (chacun ses thématiques obsessionnelles) et que les longs extraits ont laissé apercevoir toute la finesse de Claude Pujade-Renaud.