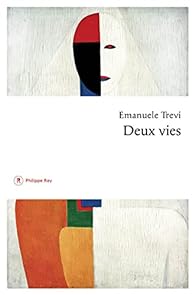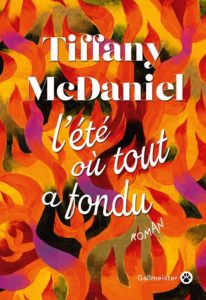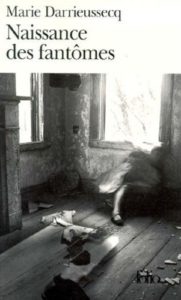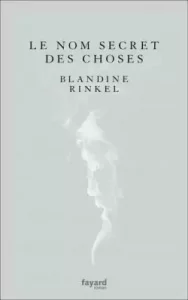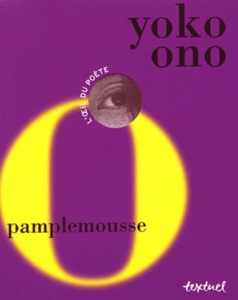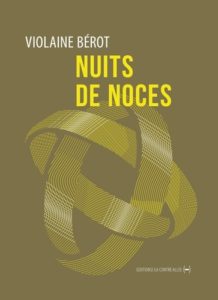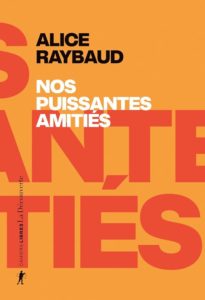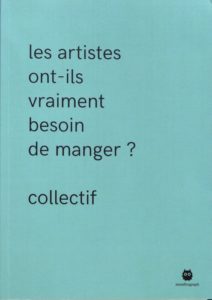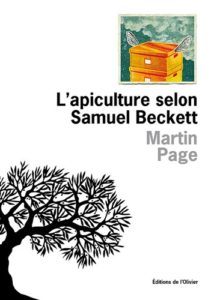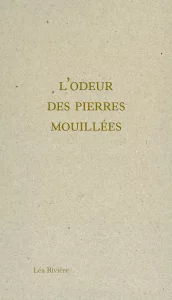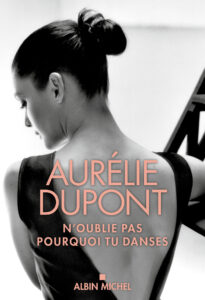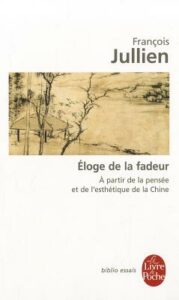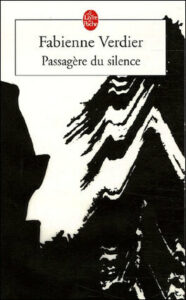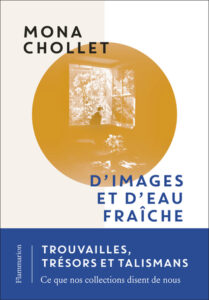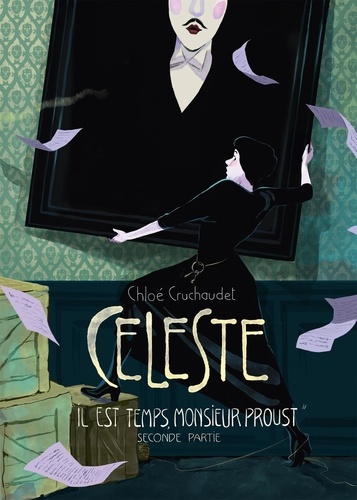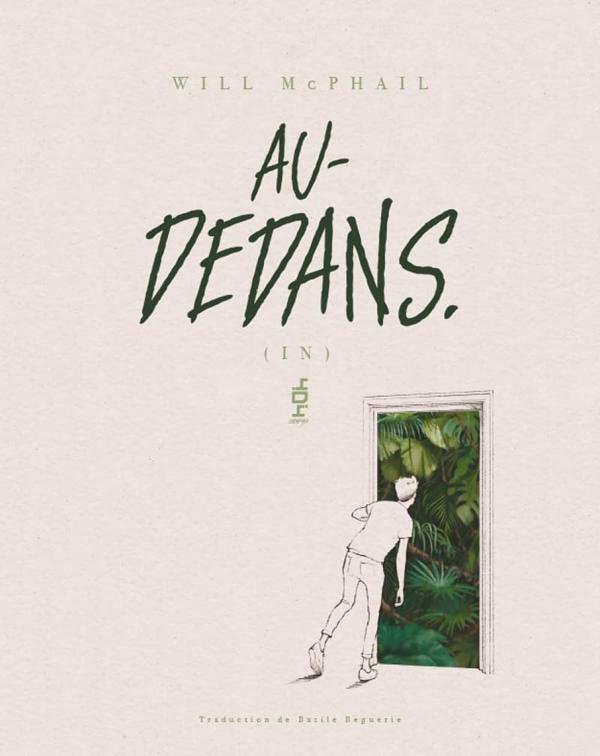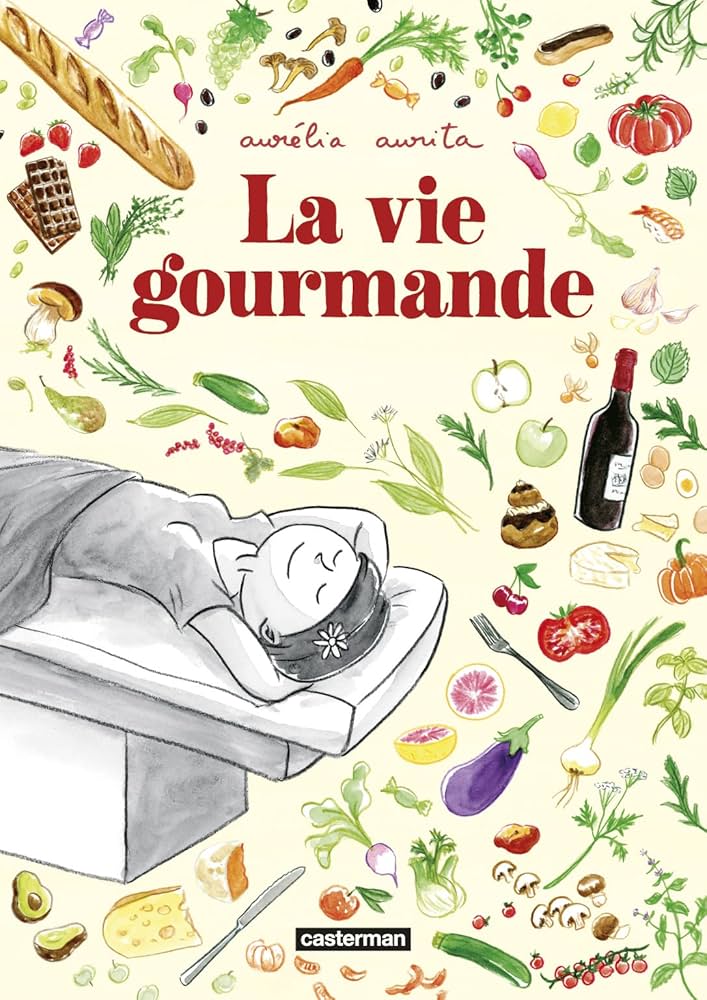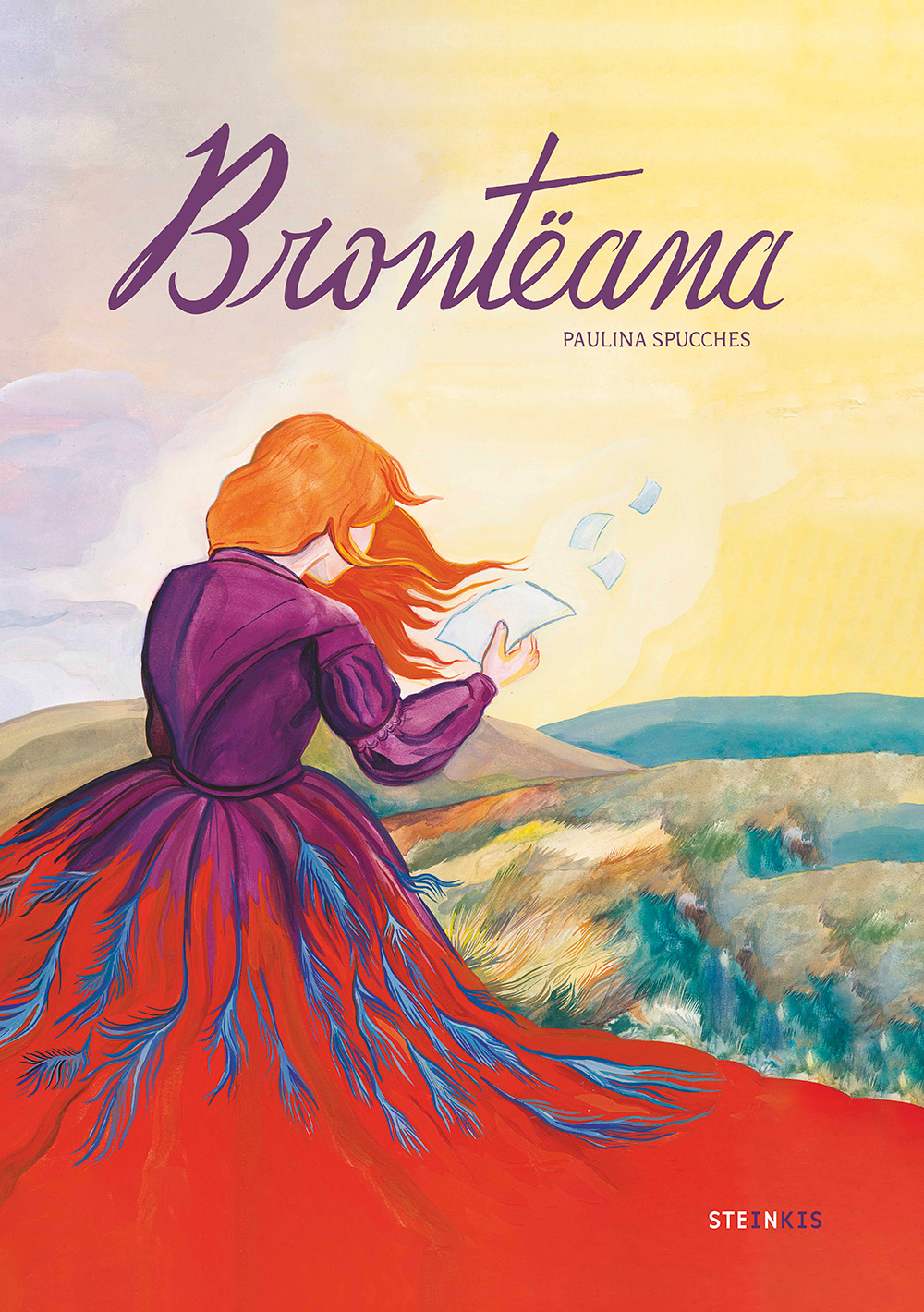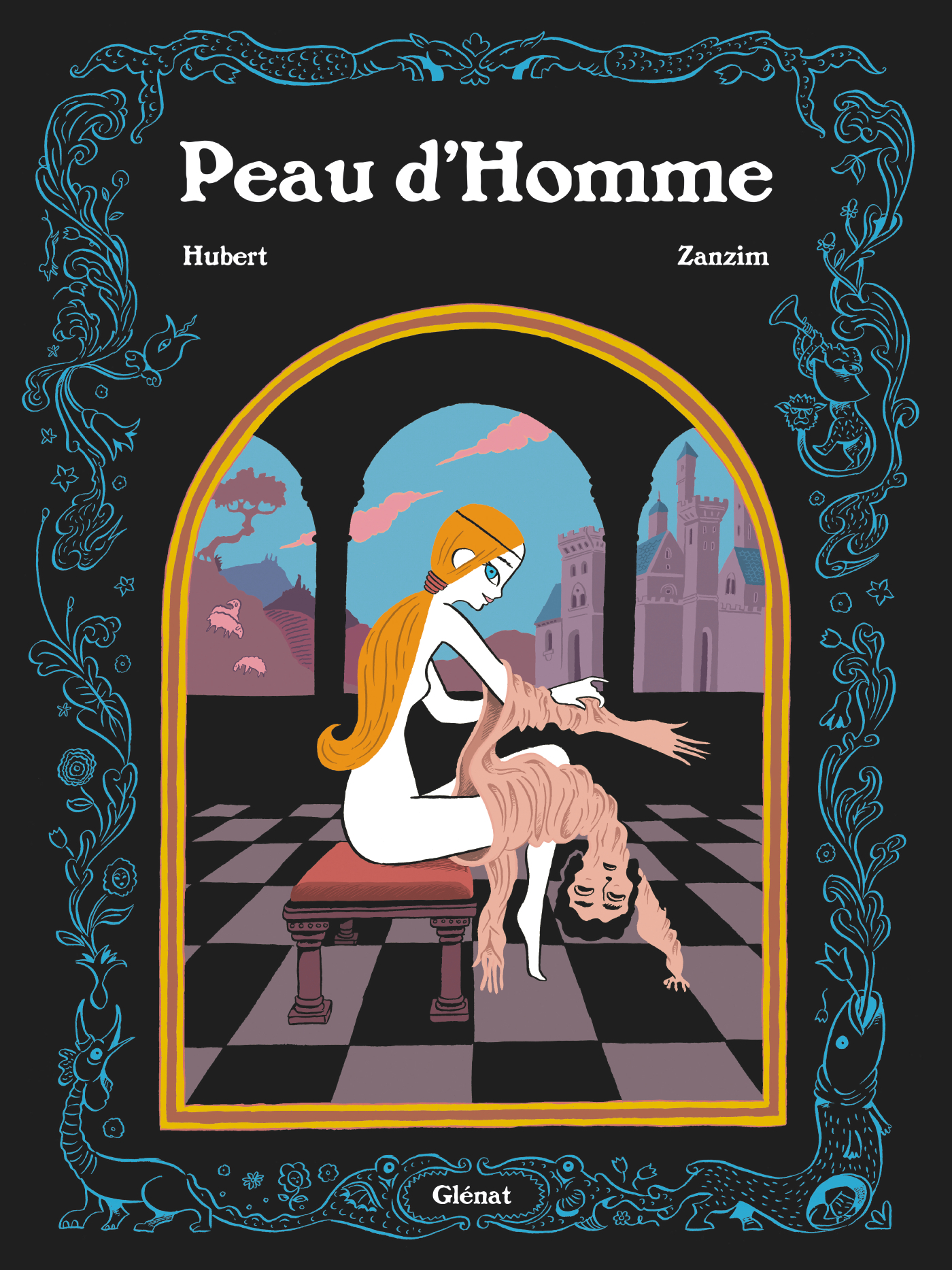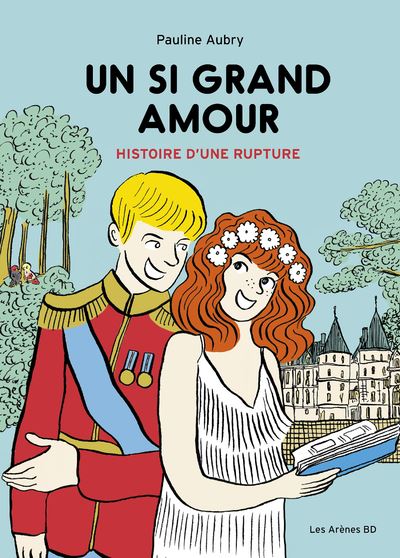Journal de lecture : L’Appel des odeurs de Ryoko Sekiguchi
(l’autrice de Nagori, la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter)
L’Appel des odeurs : un récit à la première personne. Non, un roman à la troisième. Disons un assemblage de citations et de récits. Des nouvelles, presque. À la troisième personne féminine, comme un seul et même sujet sensible qui se diffracte en diverses personnalités disséminées dans des temporalités et des géographies différentes. Elle : doubles de l’autrice-narratrice, souvent artistes (joaillère, artiste textile, plasticienne, gastronome…). Les citations qui entrecoupent ces vie parallèles sont parfois issues d’autres livres, plus souvent du carnet de notes olfactives de la narratrice. Cette dernière a une passion extraordinaire mais des capacités olfactives lambda, auxquelles on peut s’identifier sans avoir à s’imaginer nez chez un parfumeur ou complice de Jean-Baptiste Grenouille. Ryoko Sekiguchi nous tend ses histoires comme autant de boîtes de thé, et celui-ci ? On met notre nez dedans, on le fronce parfois, parfois ah là il y a matière à infuser, on renifle, on écarte, on s’attarde.
Au cours de ma lecture, je repense à l’exemple d’un ouvrage de cartographie où étaient dessinées en couleur les aires de certains effluves urbains, pain frais, pisse, encens, beuh, herbe tondue, poubelles sorties, friture… Je repense à cette randonnée en altitude en période de règles, où le soufre semblait peu à peu remplacer l’oxygène. Évidemment, je porte le livre à mon nez. L’encre, pas de renfermé : il circule beaucoup, fréquemment emprunté. Qu’est-ce que je sens d’autre ? L’Appel des odeurs est une invitation à élargir son champ de perception olfactif, à tout revisiter par ce prisme non-visuel. Tout un entraînement à mettre en place :
Toute son attention était concentrée sur la vision que lui évoquait cette odeur. Elle se surprit à regretter de ne pas pouvoir écarter les odeurs parasites aussi facilement que l’on déplace un objet pour faire place à un autre.
Sens de l’invisible qui ne se dit pas, l’odorat nous fait prêter attention à une autre couche de réalité. L’adoption de ce sens mineur provoque un décollement poétique. Que sent-on que l’on ne voit pas ? Que perçoit-on que l’on ne sent pas ? Ryoko Sekiguchi a tôt fait de transformer l’odorat en sixième sens, métaphore d’une appréhension synesthésique du monde.
Lorsqu’on dit sentir une présence, que sent-on en réalité ?
(Voilà qui fait écho à ma précédente lecture : que sent La Femme aux mains qui parlent quand elle sent la détresse des animaux ?)
Les odeurs deviennent à la fois ce qui existe et qui n’existe pas. Annonciatrices de ce qui est à venir, rémanences qui persistent après le départ, elles anticipent, prolongent, rêvent la présence. Elles nous installent sur un continuum entre perception et imagination, à la lisière du fantastique, autorisant la métaphore à basculer dans le surnaturel. Tantôt persistante, tantôt évanescente, l’odeur est par essence fantomatique, toujours à la frontière entre ce qui est et n’est pas, plus, a-t-il jamais été ?
La nouvelle où un couple d’amies éloignées (comparées à des oiseaux migrateurs <3) se font à manger l’une pour l’autre la nuit dans leurs rêves qui se répondent m’a ainsi rappelé les nouvelles fantastiques d’Ogawa. M’est également revenue en mémoire la nouvelle que j’avais écrite il y a un siècle (à l’adolescence ?) sur l’utilisation de capsules d’odeurs pour infléchir les rêves.
![]()
Une sensibilité exacerbée devient facilement pour moi synonyme d’inconfort physique et de psyché épuisée en atermoiements. Dans L’Appel des odeurs, elle semble n’être que sensualité délicate, synesthète. Un peu comme dans les récits sur la haute gastronomie (il y en a d’ailleurs), on y est souvent sur le fil du précieux : perception d’une finesse rare à chérir… ou si perchée qu’elle me lasse. Il en a résulté une lecture à plusieurs vitesses ; j’ai pris mon temps quand ça tintinnabulait délicatement au bon endroit, et accéléré quand les aigus saturaient ma perception.
Parmi les passages dont j’ai pleinement goûté la délicatesse, il y a celui sur le théâtre de Ferrare. Il y a à lire ces quelques pages la volupté qu’on peut trouver à laisser sa main caresser le velours rouges d’une loge.
Lorsqu’elle pénétrait dans ce théâtre, il lui semblait s’introduire chez sa confidente.
Sa peau aussi aspirait à sentir. La suite des dentelles lui apparut alors : une silhouette, avec un décolleté. […] Elle serra les yeux plus fort mais le visage ne se dévoilait toujours pas.
Des applaudissements s’élevèrent dans la salle pour accueillir les musiciens. Comme de petits animaux tapis dans l’ombre, ses doigts enlacèrent plus intensément ceux de la silhouette, dont la peau si lisse lui faisait perdre la tête. Elle crut entender, mêlée aux crépitements des applaudissements, une vois chuchoter qui lui demandait son nom.
À l’instant même où elle allait ouvrir les yeux pour lui répondre, le premier son de l’orchestre retentit.
![]()
Un photographe m’a dit que le plus difficile à photographier est la température ambiante. […] Deviner la chaleur dans une image.
Ou supposer l’humidité dans un tableau de l’Annonciation ?
![]()
Être seule la soulageait. La solitude était aussi apaisante et délicieuse que le parfum léger et doux du printemps précoce qui se dégageait de la marmite.
Elle huma le bouillon de toutes ses forces, et le souvenir s’en alla, avant de revenir, persistant, comme une goutte d’encre versée dans de l’eau, qui se met à tourbillonner, rendant le liquide plus opaque.
![]()
[C’est un cuisinier qui parle] Un jour, j’ai compris que je ne pouvais plus. Ce n’est pas que je ne supportais plus de tuer, car tu sais aussi bien que moi que l’on sent de la vie même dans les plantes. Plutôt comme un petit animal qui n’a plus la force d’aller affronter une bête plus grosse que lui, je n’avais plus la force de faire face à la profusion de la vie, à l’odeur du sang. Je n’en pouvais plus. C’est trop « vivant » pour moi, qui suis maintenant plus proche de l’autre côté.
Parfois, elle lui en voulait même de lui avoir fait cette confession. Ce qu’il ressentait, tous les cuisiniers l’éprouvent. De fait, ce que devraient éprouver tous ceux qui s’alimentent pour vivre était délégué aux cuisiniers.
Cela pourrait constituer le préambule d’un plaidoyer vegan si l’autrice ne se lançait pas dans un exercice de haute voltige pour esquiver la mort et la dissoudre dans la métamorphose — nécessairement ambivalente, comme la poésie et le carnivore dans le déni.
Ma fille, te crevette était délicieuse. Ta crevette était belle. J’ai eu envie de pleurer en la sentant dans ma bouche. Cette chair si onctueuse et si sucrée, je savais que ce n’est qu’en la mordant qu’elle dégagerait son parfum.
[…] Elle était bien là présente, pas comme nous, mais pas morte non plus. Elle était quelque part ailleurs, tout en étant de ce monde.
Une crevette qui ne sera pas morte en vain, en somme. Son âme sauvée par la cause gastronome. (Je plaisante, mais je comprends aussi.)
![]() Sous ses airs atemporels, L’Appel des odeurs est clairement ancré dans son époque. Le Covid n’est jamais nommé, tout au plus désigné par « la maladie », mais il est présent en sous-texte dans plusieurs récits ancrés dans l’expérience de l’anosmie. C’est là, au creux du manque, que l’aspect synesthésique est le plus flagrant : l’imagination est convoquée pour palier l’absence de l’odorat comme liant entre les autres sens.
Sous ses airs atemporels, L’Appel des odeurs est clairement ancré dans son époque. Le Covid n’est jamais nommé, tout au plus désigné par « la maladie », mais il est présent en sous-texte dans plusieurs récits ancrés dans l’expérience de l’anosmie. C’est là, au creux du manque, que l’aspect synesthésique est le plus flagrant : l’imagination est convoquée pour palier l’absence de l’odorat comme liant entre les autres sens.
Elle ignorait que les odeurs étaient comme des sons. Son univers ne vibrait plus.
Certes, l’odorat ne lui était pas revenu, mais elle avait la sensation qu’une image était enfin projetée à travers la petite lucarne d’où elle regarnit le monde, une image qui avait soudain inondé l’espace autour d’elle, où elle se retrouvait plongée. Elle ne se rappelait toujours pas ce que c’était que sentir comme elle sentait autrefois mais ce n’était plus un problème. L’important était que le peu de perceptions qui lui restait commençait à s’unir.
Elle comprit alors que l’odeur était synonyme de désir. En son absence, il revenait à l’imagination, aux mots et à la tendresse de celui qui cuisine de venir la consoler.
Une gastronomie pour les anosmiques est-elle possible ?
![]()
La personne part dans l’au-delà avec ses secrets. Tout ce que peuvent faire les vivants, c’est de raconter des histoires, sans savoir si elles sont vraies ou non.
Le cœur de cette fille était un immense réceptacle, et c’est bien ce qui attirait les hommes. Mais il ne fallait en aucun cas qu’ils s’en aperçoivent, et c’est la raison pour laquelle il créait sans relâche pour elle de nouveaux parfums, pour que les autres se méprennent sur sa fragilité et lui attribuant plutôt un talent de simulatrice avec ses effets olfactifs.
Les acouphènes olfactifs existent-ils ?
Les odeurs qu’on a dans le nez.
Qu’elles soient bonnes ou mauvaises, la présence des odeurs l’enchantait. Tout semblait émettre un scintillement. Une chaleur. […] Elle se sentait entourée par tellement de choses. C’était comme être de retour d’un monde où elle ne voyait plus.
Les tableaux qui véhiculent un message de vanités peuvent être conservés pendant des siècles.
Je n’avais jamais conscientisé le paradoxe !
![]()
Les mots sortaient lentement de sa bouche, comme on aligne des pierres que un trait tracé au sol.
Il eut l’ait étonné face à ce cadeau inattendu, puis il la remercia d’un sourire timide. Elle trouvait son sourire magnifique. C’était comme si un arbre lui souriait.
Mieux valait ne pas penser que l’odeur était en train de s’estomper. Sa forêt était entrée dans l’heure bleue.
(L’heure bleue, nous dit-on juste avant, quand les animaux et les oiseaux cessent tout bruit.) Poétiser la disparition pour ne pas souffrir de la perte, cela m’a touchée. Ce récit-là dans son ensemble, en fait : un sculpteur offre à une autre artiste un travail préparatoire qui est en soi une œuvre, une boîte renfermant une forêt sculptée dans un bois odorant. L’odeur convoque le souvenir de leur rencontre de manière extrêmement vivace, davantage que ne le ferait une photographie par exemple, mais cette vivacité est empreinte d’une grande fragilité. L’odeur persiste, semble devoir durer éternellement, survivant même au sculpteur, jusqu’au jour, des décennies plus tard, où elle commence à s’atténuer, s’évaporer. Alors il faut convoquer l’heure bleue, faire sens de ce qui disparaît tout en laissant trace, l’odeur comme présence de celui qui n’est plus là ou plus.
![]()
Un jour, elle peut le courage de lui avouer qu’elle ne mangeait jamais ces prunes ainsi confectionnées et offertes, par crainte d’en venir à bout. […] Elle avait hésité à le lui dire, pour éviter d’évoquer, fût-ce indirectement, le jour où sa mère ne serait plus.
Sa mère lui avait confié qu’elle n’avait jamais osé les toucher, parce qu’une fois ces prunes mangées, elle n’en aurait jamais plu, sa grand-mère ayant quitté ce monde. « De temps en temps, je ramasse juste un peu de sel qui s’est détaché des fruits, et je le est dans ma bouche. Et j’arrive à imaginer que ma grand-mère est là, le temps que le sel fonde. »
Parmi les chose qu’un personne peut laisser derrière elle, la nourriture est peut-être la plus étonnantes de toutes, car elle est dotée d’une odeur et d’un goût que les vivants peuvent assimiler. Le contact physique est réel. Seulement, on ne peut sentir le goût qu’en la détruisant, alors que son odeur continue d’exister quand on la hume. L’odeur, infiniment résistante et généreuse.
Sans être lié à personne en particulier, mon rapport à la dégustation n’a jamais été si bien exprimé. Comment profiter pleinement de quelque chose qui cesse dans le même moment ? Ce chocolat Patrick Roger n’existera plus jamais quand je l’aurai avalé ; ma dégustation se doit d’être à la hauteur, pour créer un souvenir à la mesure de la disparition, pour la compenser, la combler en quelque sorte. Souvent je laisse ainsi les bonnes choses se périmer, préférant grignoter distraitement une tablette que je sais pouvoir retrouver au coin de la rue à bon marché plutôt que risquer d’échouer à savourer comme il se doit l’exceptionnel en pleine conscience. Je laisse se gâter par peur de gâcher.
![]()
Elle fermait les yeux et essayait de le défaire des moments de son passé, comme on décolle l’étiquette d’un flacon, pour lui rendre sa virginité. Les paupières closes, elle s’emparait dans sa tête d’un pinceau pour chasser les images qui leur étaient associées, les émotions qui les accompagnaient. […] Peu à peu, comme la lie se dépose au fond d’une bouteille, le pathos fondu dans le liquide se condensait vers le haut du flacon pour s’échapper.
Extraire sa vie des flacons était en réalité un acte destiné à faire renaître ses souvenirs, et à vivre avec eux. Car qui a décidé qu’un moment du passé doit demeurer dans le passé ? […] Il se pourrait que le passé continue à vivre sa vie dans le présent.
Cette séance de soprophologie-psy vous a été offerte par Ryoko Sekiguchi. (J’adore la mise à jour des mécanismes psychologiques, l’image du pinceau manié par une archéologue de l’intime.)
![]()
En cours de lecture, j’ai laissé L’Appel des odeurs sur le tabouret des toilettes. Je ne suis pas la seule à m’être aperçue de l’ironie.