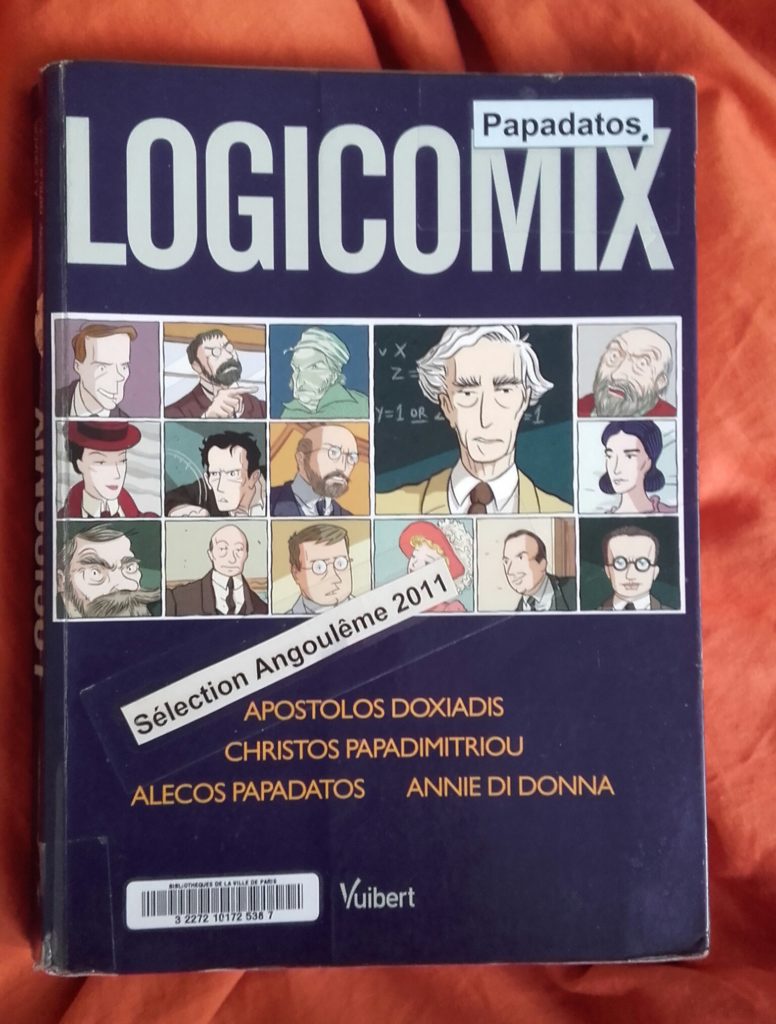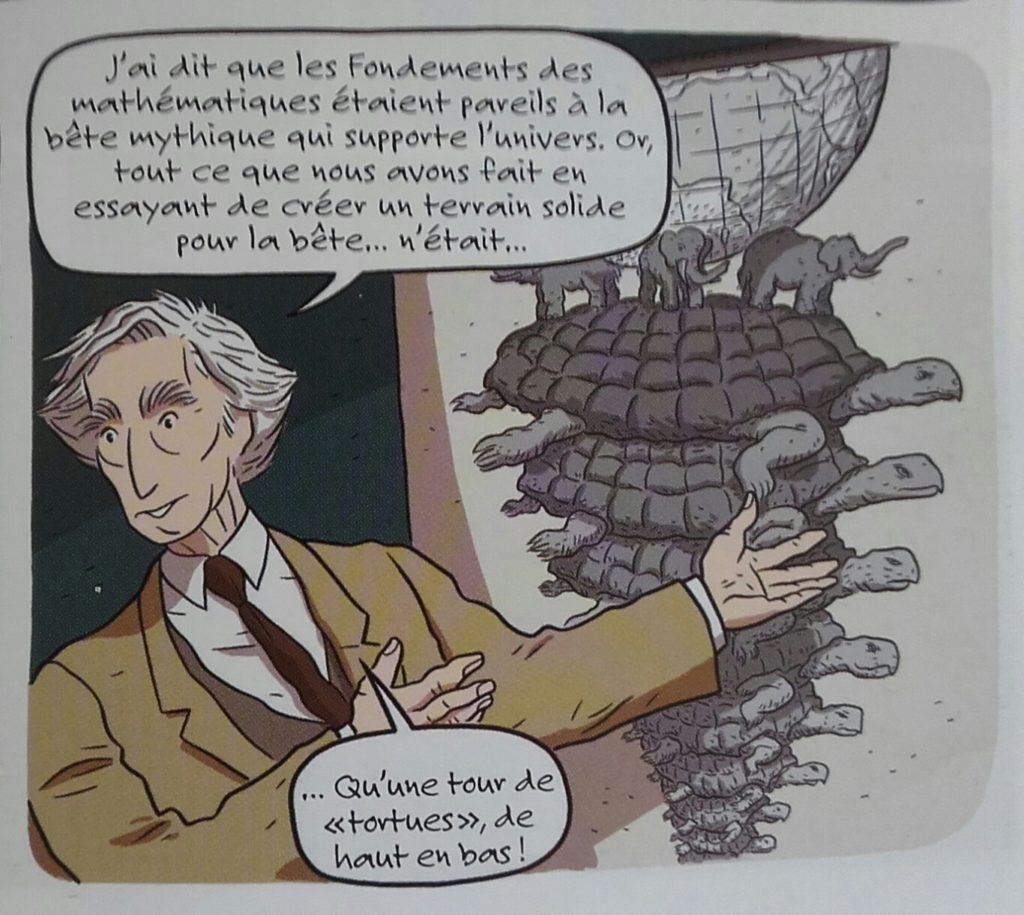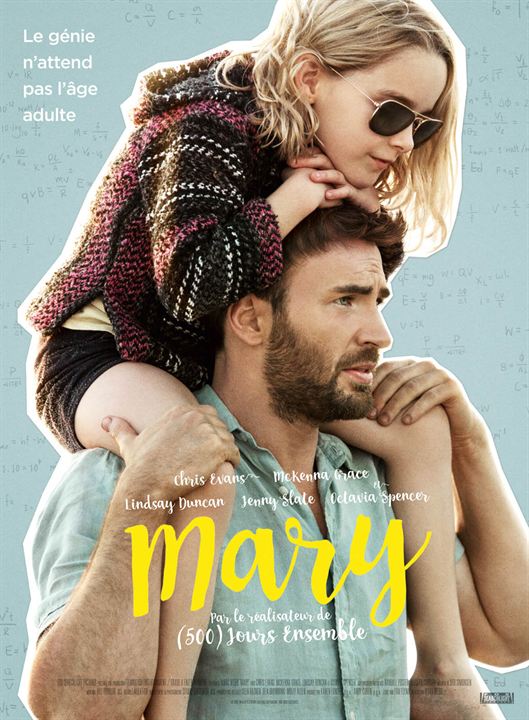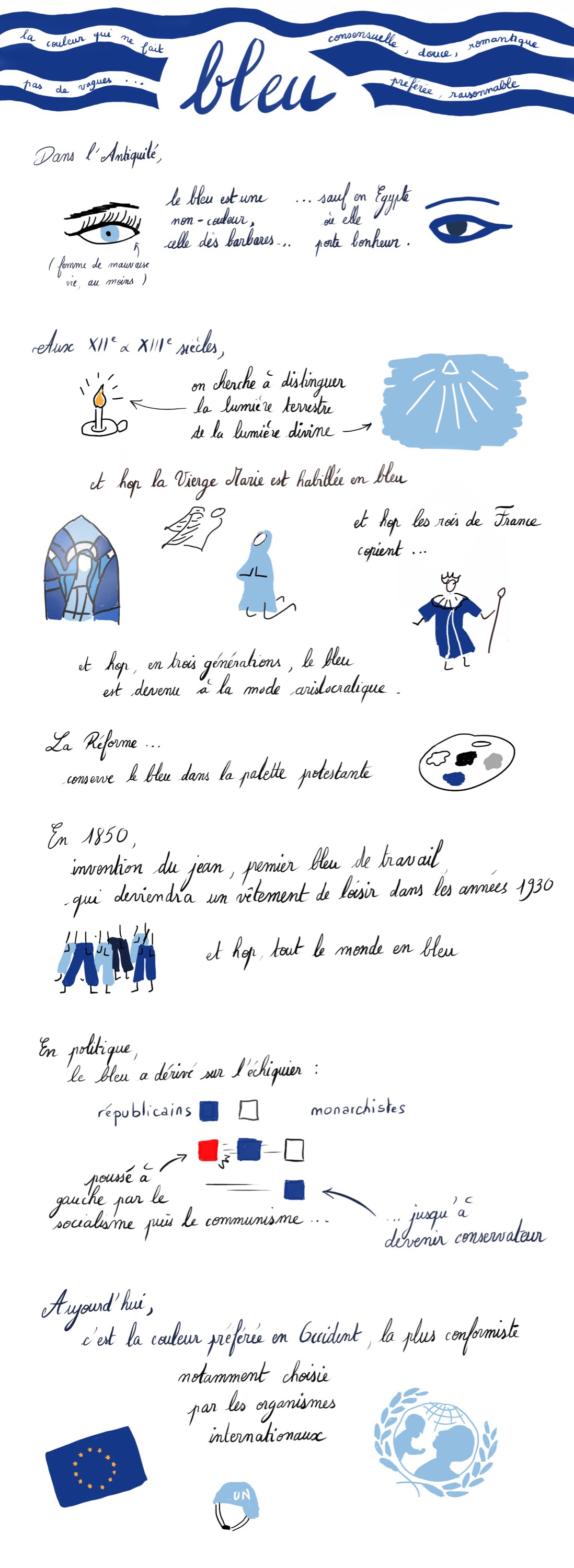J’étais réticente à aller voir 120 battements par minute que j’imaginais trop plein d’indignation (épuisante) et de bons sentiments (indigestes), mais les actions menées par les militants d’Act Up représentent une part finalement moindre que les discussions internes politiques-éthiques-scientifiques, et la réalisation reste sobre – voire crue quand cela est nécessaire : faire l’amour y est bien une affaire de sexe et de sperme, comme le sida, qui fait mourir sans euphémisme, deux morceaux de sparadrap pour maintenir les paupières fermées.
« Ce qui m’intéressait […] c’était l’étrangeté de l’état second dans lequel on est dans ces situations-là. Cette tonalité me semble plus honnête vis-à-vis du spectateur, plutôt que de chercher à le faire pleurer. J’ai vécu la scène où je rhabillais un copain mort et sa mère lui parlait. Je ne me souviens pas d’avoir été ému, mais il y avait justement une inquiétude diffuse à ne pas l’être. »
L’Histoire, via l’histoire d’une association, peu à peu s’efface et s’incarne dans une histoire d’amour et de mort. Mélo et militantisme s’empêchent et s’équilibrent l’un l’autre : cela se ressert, la gorge, du collectif au couple, dans l’impudeur des corps et la pudeur des sentiments. 120 battements de cœur par minute : dans l’amour, la peur et la danse – seule concession lyrique où les paillettes de poussière du dancefloor se mettent à flotter et dérivent parmi le virus et les cellules infestées.
* * *
En plein débat avec les laboratoires pharmaceutiques, la lumière se rallume dans la salle. Au bout de cinq minutes, un employé du cinéma vient nous expliquer que le courant a sauté dans tout le quartier et que le projectionniste (un seul pour les seize salles du complexe) devrait relancer le film dans les dix minutes. L’annonce est accueillie par une nuée de claquements de doigts : substitut aux applaudissements préconisé par Act Up lors de ses réunions pour ne pas couvrir la voix de l’orateur. Jolie connivence de salle.
(En réalité, une seconde coupure de courant a retardé la reprise et l’entracte impromptu a duré, si l’on en croit le retard à notre sortie, plus de 45 minutes.)
* * *


* * *
Mérite de 120 battements par minute, en-deça même de ce qu’il est un bon film : refaire parler de la maladie et de sa prévention par sa seule existence. Ma collègue de 40 ans me racontait qu’Act Up, c’était son adolescence et qu’elle suivait ça un peu ahurie depuis son lycée de province. À mon tour, je lui ai expliqué que 10 ans plus tard, on ne comprenait pas pourquoi on nous rabâchait toujours la même chose : on ne pensait même pas encore au sexe que le préservatif était déjà une évidence, et les MST une espèce d’ombre de la sexualité qui ne donnait pas spécialement envie d’en approcher. Apparemment, aujourd’hui, la banalité du discours et les traitements de plus en plus efficaces contre le sida auraient tendance à entraîner une prise de risque accrue – d’où le bon timing du film.
« […] j’avais besoin de me confronter aux jeunes d’aujourd’hui parce qu’on n’en a jamais fini avec le sida. J’ai connu l’époque de l’insouciance avant, c’était extrêmement joyeux. Je ne me remets pas que ça soit devenu grave. »
Les citations sont extraites de l’interview de Robin Campillo pour Trois couleurs.
Une histoire de gays ?
« Confiner cette maladie a ‘l’intimité’ quand il s’agit de gays, ça rappelle le placard, je ne voulais pas être là-dedans. Être enfermé dans l’intime, c’est être invisible. C’était la même chose avec l’avortement avant le manifeste des 343 en 1971 : ça arrangeait tout le monde que ça soit une expérience individuelle, que les femmes aillent en Belgique ou en Angleterre. Avec Act Up, on a dit : « Non mais, attendez, c’est pas une maladie de l’intime, c’est une épidémie, donc ça a à voir avec la politique, avec la santé publique ! » »
Et sur les scènes de sexe :
« On a fait des répétitions torses nus, je ne voulais pas qu’ils arrivent sur le plateau en mode « on baise » et qu’on fasse une scène de Kama Sutra gay. Ce qui m’intéresse, c’est que ce n’est pas si évident de trouver des positions. D’abord, ça m’excite plus que la performance, je vois plus le côté humain, et ça me touche beaucoup. Le film est produit par France 3, donc je ne pouvais pas filmer de pénis, mais je n’avais de toute façon pas envie de tourner la scène de manière pornographique – même si ça m’intéressait de faire un film porno un jour. Par contre, je voulais montrer les à-côtés importants, qui sont tout le temps évacués au cinéma : mettre une capote, bien mettre du gel, comment on enlève le préservatif… Pour le coup, on voit du sperme qu’on essuie – ça, visiblement, c’est pas interdit. Y’a plein de choses que les gens trouvent glauques, alors que pour moi c’est extrêmement romantique […]. »