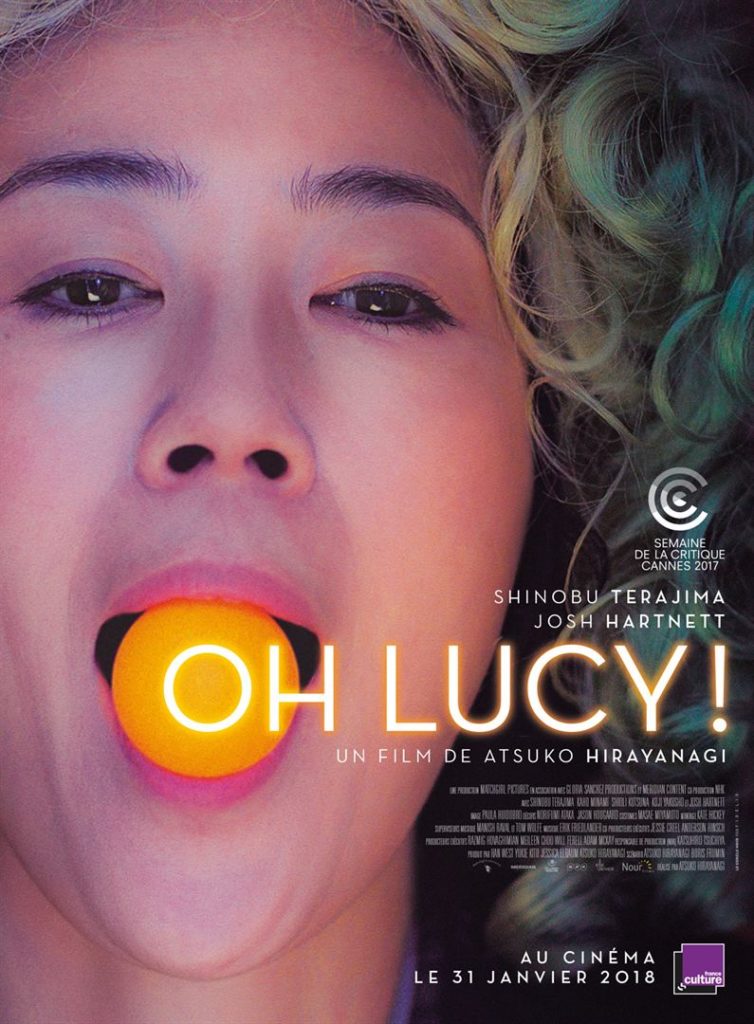O Mensch! a été composé pour Georg Nigl et cela s’entend. Le baryton a une présence bien à lui, une voix qui s’impose en s’escamotant, comme sa petit moustache sous les projecteurs. Debout ou assis sur une chaise de bar sans bar, il emboîte le pas de Nietzsche, et nous le sien, pour une promenade-errance. Peu à peu, un chemin se dessine entre les fragments du philosophe et les résonances-dissonances du piano qui abandonne autant qu’il accompagne ; et alors ce sont les grésillements de la nuit, le chant des cigales, si tenace et ténu qu’on se demande s’il était là en même temps que la voix ou si un technicien vient d’ouvrir la vanne de la Provence1. J’aime beaucoup cette toile de fond sonore et l’obscurité périodique de la scène, d’où la voix peut ressurgir. Une voix plus qu’un chant, qui s’oublie dans son intimité avec la parole, le bruissement et le murmure. L’éructation, aussi, quand la pensée se fait contre-soi désagréable ; alors les lumières se rallument sur nous, le public, que le baryton prend à parti, et c’est grinçant comme sait l’être l’opéra de quat’sous. Puis sans qu’on sache comment, nous voilà repartis dans les portraits champêtres, alpestres ou marins de la nature traversée par l’homme, jusqu’au rivage où l’on ne peut plus avancer, où l’on ne peut plus que lever la tête vers l’obscurité et voir la constellation de ce que l’on n’a pas pu saisir scintiller doucement : des bouts des cailloux bruts qui restent quelque part, là, hors de notre portée mais non de notre admiration. La musique de Pascal Dusapin est exigeante, mais elle touche juste, même quand on ne sait pas trop quoi… au juste.
Par comparaison, Morning in Long Island me fait un effet moindre, le lendemain. Peut-être parce qu’on est en pleine après-midi, dans une salle qui encourage la somnolence2. Non seulement le morning est jet-lagué, mais j’imagine très clairement Long Island à San Francisco, dans un collage des quais, de la petite plage donnant sur le Golden Bridge et de l’autre, l’immense étendue du Pacifique, que je colle dans la baie. Avec le brouillard, c’est autorisé et ça s’estampe : la musique se propage dans le paysage comme un trait d’encre posé sur un papier déjà gorgé d’eau. On voit, on entend l’encre s’engouffrer silencieusement dans la fibre – une touche et c’est tout un aplat. Peu à peu, le temps se dégage et c’est alors celui de la ville que l’on commence à sentir comme tantôt l’iode et le froid traversé par les mouettes (engourdies, à terre : des pigeons de plage). Le rythme de la ville vous vient aux narines, s’insinue et se propage à tout le corps. C’est exactement la première fois que je remontais le district financier pour aller aux piers, attirée-enivrée par la musique d’un batteur sauvage, en plein milieu du trottoir, avec ses rastas au vent et ses grosses caisses de récupération.
Après l’entracte vient mon quatrième Château de Barbe-Bleu de Bartók, dont je fais cette fois-ci le tour en propriétaire, un peu déçue qu’aucun insoupçonné ne se révèle à moi. Du coup, je m’essaye une fois de plus à la mise en scène. J’hésite à éclairer les portes en rouge ou en blanc. Ou un rouge qui s’atténuerait au fur et à mesure de la découverte de chaque pièce ? ou à partir de la cinquième porte ? J’ai également un problème avec la quatrième porte qui, au milieu des six autres disposées en arc-de-cercle, se trouve face au public, qu’elle risque donc d’éblouir. Et je ne sais pas où disposer les chanteurs. J’abandonne l’opéra et passe à la chorégraphie. J’étais en train d’imaginer du mauvais Béjart abâtardi par du médiocre Roland Petit quand il a heureusement été temps d’applaudir Nina Stemme.