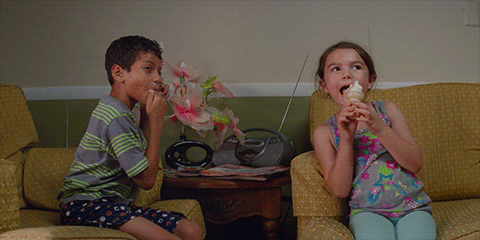Les fringues et les jouets de Moonee, les cheveux de sa mère, les murs du motel où elles (vivent ? survivent ? vivotent ? glandent ? s’amusent ?), toute la photographie de The Florida Project a des couleurs de bonbecs. Difficile de voir la vie en rose quand on n’a pas d’éducation, pas de revenu et pas envie de trimer — mais en mauve, c’est possible, et c’est ce que fait le réalisateur Sean Baker en se plaçant à hauteur d’enfant. Sans jamais prendre de haut Moonee, ni sa mère, pourtant plus gamine que sa fille, il filme la manière dont elle habite ses journées de vacances, le motel et les alentours1, les glaces quémandées, les autres enfants avec qui elle s’ennuie et s’amuse, les inventions pas croyables et souvent pas très charitables, les ânerie qui s’en suivent (cette enfant est un nid à conneries) ; les suppliques de Moonee pour revoir son copain de la chambre d’à côté et l’œil au beurre noir de la mère de celui-ci ; les rodéos en caddy au supermarché, poussée par sa mère ; la revente de parfums de contrefaçon avec sa mère devant les hôtels des environ, et de retour au motel, les bains à savonner la crinière de petits poneys pendant que sa mère fait, heu, fructifier le résultat du concours de selfies en maillots de bain.

Les problèmes d’adultes ne sont pas évacués, mais ils sont filmés comme des problèmes d’adultes, comme les voit un enfant : trop bien, mais de loin, sans s’appesantir sur les causes ni en attendre de conséquences. Suspension du jugement : le spectateur porte sur le duo mère-fille le même regard que le manager (et non le propriétaire) du motel. Bobby, génialement joué par Willem Dafoe, ne veut pas jouer le rôle d’un flic ou d’un père, mais veille au grain : il accepte que les gamines viennent se cacher sous son ordinateur lors d’une partie de cache-cache, mais vend la mèche au troisième larron pour qu’elles dégagent rapidement ; fout les mômes dehors à la seconde où ils font tomber de la glace par terre, mais rapplique dare-dare lorsqu’un vieux monsieur vient chercher un soda près de l’aire de jeux ; exige le paiement d’avance du loyer après plusieurs retards, mais est prêt à avancer la différence lorsque le motel d’à côté augmente ses prix et empêche les résidents longue durée d’alterner le temps d’une nuit pour être réinscrits dans leur motel d’origine comme nouveaux clients (le règlement interdit les installations pérennes).

Le réalisateur explique avoir adopté une approche quasi-journalistique pour préparer le film. En lisant l’interview qu’il a donnée à Vice, j’ai mieux compris le titre, The Florida project, que je ne voyais que comme un énième avatar d’une mode managériale étendue à tous les domaines2 — moins un résumé emblématique du film qu’un commentaire sur la démarche du réalisateur : tout milieu a le droit à sa représentation dans la fiction.
C’est pourtant sous l’angle humain et non social qu’est filmé The Florida project3, et c’est pour cette raison que j’ai aimé le film et que je vous invite à aller le voir, malgré une fin bâclée (… sur le plan formel ; sur le plan narratif, la boucle était bouclée). Ce n’est pas tous les jours qu’on voit des enfants incarner autre chose que des personnages d’enfants : ils ne sont pas ici des appendices parentaux, mais des êtres avec leur personnalité, leur langage et leur gestuelle propres (ventre en avant, poignet démonstratif, sourire crâne). Et Brooklyn Prince, qui joue Moonee, est manifestement un sacré numéro.