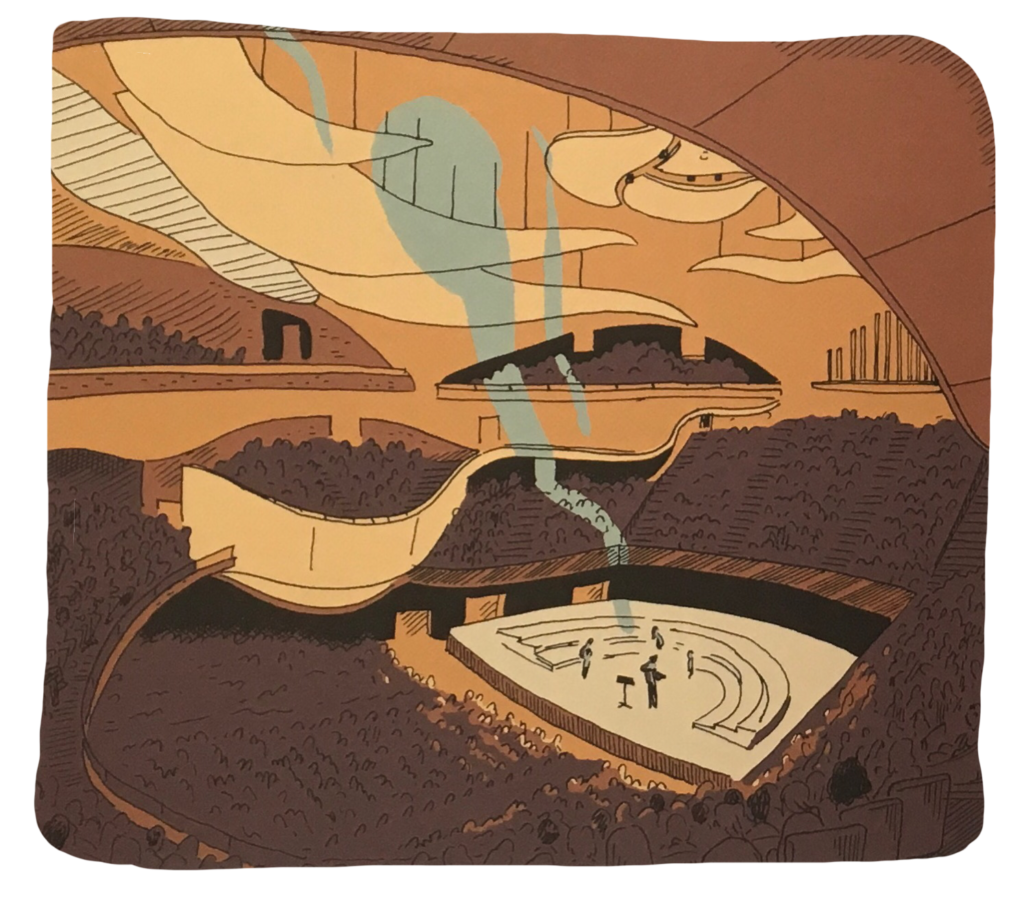Ce corpus de confinement ne rassemble pas mes grignotages culturels du moment. Ce sont des textes et des scènes qui me reviennent avec insistance en ce moment, surgissant parfois de loin pour reprendre à leur compte une partie de ce qui se vit et s’éclaire ainsi d’échos plus connus. J’ai eu envie de les rassembler pour garder une trace de ces réminiscences hétéroclites. J’en ferai peut-être une mise à jour si d’autres passages me reviennent ou que je retrouve des extraits plus précis.

Sans jamais dire où je vais,
Je veux faire ce qu’il me plaît !
Mood : Simba.
Attitude : remplir des attestations de déplacement.
Ce lion est une tête de mule.


Dans cet épisode, Robin développe une obsession pour Barney parce que celui-ci a définitivement renoncé à lui courir après – tout comme, se découvrant allergique au homard, elle s’était rendue malade à répétition en ne voulant plus que cela.
Soit Robin, une introvertie casanière ;
soit l’allergie, un confinement ;
le homard devient : l’extérieur et la sociabilité.

Je te caresse. Je t’appelle à la vie. De cette masse fraternelle que j’ai à peine vue dans mon éblouissement, je forme mon frère avec tous ses détails. Voilà qu j’ai fait la main de mon frère, avec son beau pouce si net. Voilà qu j’ai fait la poitrine de mon frère, et que je l’anime, et qu’elle se gonfle et expire, en donnant la vie à mon frère. Voilà qu je fais son oreille. Je te la fais petite, n’est-ce pas, ourlée, diaphane comme l’aile de la chauve-souris ?… Un dernier modelage, et l’oreille est finie. Je fais les deux semblables. Quelle réussite, ces oreilles ! t voilà que je fais la bouche de mon freèe, doucement sèche, et je la cloue toute palpitante sur son visage. Prends de moi ta vie, Oreste, et non de ta mère !
Électre, Giraudoux, acte I scène 8
[…]
Elle se doute que nous sommes là, à nous créer nous-mêmes; à nous libérer d’elle. Elle se doute que ma caresse va t’entourer, te laver d’elle, te rendre orphelin d’elle… Ô mon frère, qui jamais pourra me donner le même bienfait ?
N’avoir aucun contact physique d’aucune sorte pendant plusieurs semaines : j’aurais besoin qu’une main vienne réactualiser mes contours, me faire exister un peu plus nette.

Cet épisode […] m’apprit donc à regarder mes habitudes avec méfiance; non pour l’effet lénifiant qu’on leur prête d’ordinaire, mais au contraire, parce qu’elles suscitent leur propre antivenin, radical et imprévisible, à tel point qu’il n’existe plus à mes yeux de vraies habitudes.
Journal imaginaire de Raveline, « Sevrage«
Je ne sais pas si j’ai envie de reprendre ma vie normale ou, au contraire, de la faire partir dans un sens qui ne me ressemble pas.

[Un extrait de L’Espoir que je n’ai pas retrouvé dans mon Folio annoté, que j’ai peut-être inventé, parce que c’est une image qui me reste : celle d’une place avant ou après les combats, rendue irréelle par le soleil et les pigeons.]
Le plus étrange, dans une situation anormale, c’est tout ce qui reste obstinément normal.

Le livre est resté chez ma mère et je ne retrouve pas l’extrait en ligne, mais intervenait dans Artemis Fowl une « bio-bomb », capable de tuer tous les êtres vivants sans endommager le moindre bâtiment : c’est l’impression que m’ont faites les rues vides dans les premières semaines du confinement. (Maintenant c’est un week-end du 15 août qui n’en finit plus.)

Vivre, il n’y a là aucun bonheur. Vivre : porter de par le monde son moi douloureux. Mais être, être est bonheur. Être : se transformer en fontaine, vasque de pierre dans laquelle l’univers descend comme une pluie tiède.
L’Immortalité, Kundera
J’y repense souvent, quand la joie reflue et semble soudain une succession de tâches infinie. Et aussi quand je suis juste contente de sentir l’air sur mon visage et voir les arbres frémir en buvant ma tisane à la fenêtre.